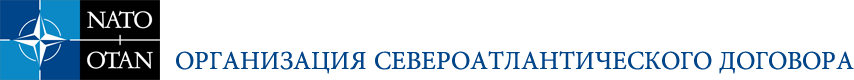Coopération capacitaire multinationale
Pour mener à bien ses opérations, ses missions et ses autres activités, l’OTAN a besoin que les Alliés investissent dans des équipements de pointe interopérables et d’un bon rapport coût-efficacité. L’OTAN joue là un rôle important : elle aide les pays à décider des modalités de leurs investissements de défense et des domaines à privilégier en la matière. L’OTAN aide également les Alliés à définir et à développer des projets de coopération multinationale, y compris des projets à haute visibilité, destinés à fournir les capacités de défense clés nécessaires à la sécurité de l’Alliance.

Un avion de chasse est ravitaillé en vol par un avion multirôle de ravitaillement en vol et de transport (MRTT), une des capacités multinationales que les Alliés ont développées ensemble.
- L’OTAN aide les Alliés et les pays partenaires à recenser les possibilités de coopération capacitaire multinationale et à développer des projets à haute visibilité dans des domaines clés, comme le ravitaillement en vol, les munitions, les drones, la défense aérienne et antimissile, le commandement et le contrôle, et l’entraînement.
- Le but est de réduire les coûts grâce à des économies d’échelle tout en améliorant la valeur ajoutée sur le plan opérationnel grâce à une mise en commun accrue des équipements, de l’entraînement, des doctrines et des procédures.
- L’OTAN travaille avec l’Union européenne pour éviter les doubles emplois et garantir la complémentarité des travaux.
Projets à haute visibilité
Les Alliés ont lancé vingt-neuf projets, qui permettront d’accroître l’efficacité opérationnelle, de réaliser des économies d’échelle, et de renforcer la connectivité entre les pays membres et les pays partenaires de l’OTAN. Ces projets concernent des domaines capacitaires clés, comme le ravitaillement en vol, les munitions, les systèmes maritimes sans équipage à bord, le commandement et le contrôle, et l’entraînement. Les projets actuellement en cours, et qui en sont à différents stades, sont les suivants :
Commandement et contrôle
- Commandement conjoint de composante Opérations spéciales (C-SOCC)
- Commandement régional de composante Opérations spéciales (R-SOCC)
Structures d’entraînement
- Programme multinational pour l’aviation des forces spéciales (MSAP)
- Initiative OTAN d’entraînement au pilotage – Europe (NFTE)
- Environnement d’entraînement synthétique multisites
Acquisition d’équipements de haute technologie
- Flotte d’avions multirôles de ravitaillement en vol et de transport (MRTT-C)
- Aéronefs maritimes multimissions (M3A)
- Systèmes maritimes sans équipage à bord (MUS)
- Capacité giravion de nouvelle génération (NGRC)
- Systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS)
Défense aérienne et antimissile
- Capacité de commandement et de contrôle pour la défense aérienne et antimissile de surface aux niveaux du bataillon et de la brigade (couche C2 pour la SBAMD)
- Solution modulaire pour les capacités de défense aérienne basées au sol (GBAD modulaire)
- Moyens rapidement déployables de lutte contre la menace roquettes-artillerie-mortiers (C-RAM)
- Menaces aériennes évoluant à très basse altitude
- Capteurs passifs de surveillance aérienne
Mobilité militaire et contre-mobilité
- Franchissement de coupure
- Contre-mobilité
- Véhicules et systèmes du génie militaire
Munitions
- Munitions tactiquement décisives (Air) (ABDM)
- Munitions tactiquement décisives (Terre) (LBDM)
- Munitions tactiquement décisives (Mer) (MBDM)
- Initiative pour l’entreposage multinational de munitions (MAWI)
- Essai, évaluation et certification de l’interchangeabilité des munitions de tir indirect
Défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN)
- Réseau d’installations de défense CBRN
- Équipements de protection CBRN
- Détection et identification d’agents CBRN
Technologies spatiales
- Capacité alliée de surveillance permanente depuis l’espace (APSS)
- NORTHLINK
- STARLIFT
En outre, les pays continuent d’examiner des domaines prometteurs pour la coopération multinationale, le but étant d’assurer la sécurité avec des solutions d’un bon rapport coût-efficacité.
Commandement et contrôle (C2)
Le dispositif C2 se réfère aux pouvoirs et aux instructions donnés à un organisme militaire pour l’accomplissement de sa mission. Le C2 est essentiel pour mener à bien les opérations de l’OTAN et est la garantie du bon déroulement et de l’efficacité de ces dernières. Les projets ci-dessous sont des exemples de la manière dont le C2 peut être géré à un niveau multinational.
Commandement conjoint de composante Opérations spéciales (C-SOCC)

Objectif : les forces d’opérations spéciales opèrent de plus en plus souvent dans un contexte multinational. C’est pourquoi il est essentiel qu’un quartier général multinational en assure la gestion. Le C-SOCC combine des capacités nationales des trois pays participants pour que ceux-ci puissent déployer et commander des groupes opérationnels d’opérations spéciales dotés de capacités supérieures à la somme de leurs parties. Le C-SOCC peut être mis à la disposition du modèle de forces de l’OTAN et pourrait aussi fournir un soutien pour les missions et opérations de l’OTAN.
Participants : Belgique, Danemark et Pays-Bas.
État d’avancement : mis en place et en cours d’exécution. Le C-SOCC a été lancé en février 2017 et il est devenu pleinement opérationnel en décembre 2020.
Commandement régional de composante Opérations spéciales (R-SOCC)
Objectif : le R-SOCC met à la disposition des pays participants un quartier général temporaire déployable conçu pour la gestion des opérations de forces spéciales. Ce commandement, placé sous la direction de la Hongrie, renforce la capacité des pays participants à utiliser efficacement leurs forces d’opérations spéciales, individuellement ou de concert. La présence de forces d’opérations spéciales performantes dans l’ensemble des régions de l’Alliance rend l’OTAN mieux à même de répondre rapidement aux crises qui surviennent.
Participants : Croatie, Hongrie, Slovaquie, Slovénie et Autriche (pays partenaire de l’OTAN).
État d’avancement : mis en place. Le R-SOCC a été lancé en février 2019, il a atteint sa capacité opérationnelle initiale en mai 2021, et il devrait atteindre sa capacité opérationnelle totale en 2025.
Structures d’entraînement
Toutes les forces de l’Alliance ont besoin de bien s’entraîner pour pouvoir faire face à l’éventail des défis de sécurité et accomplir leurs missions. Un entraînement multinational permet aux forces de différents Alliés de s’entraîner ensemble, d’améliorer leur coordination et leur coopération et de renforcer leur disponibilité opérationnelle.
Programme multinational pour l’aviation des forces spéciales (MSAP)

Objectif : les forces d’opérations spéciales sont un outil très précieux et polyvalent permettant de répondre efficacement à l’évolution des menaces pour la sécurité. Pour renforcer davantage encore les capacités de l’OTAN dans ce domaine, plusieurs Alliés ont mis en place un programme multinational pour l’aviation des forces spéciales (MSAP) exclusivement consacré à l’entraînement des équipages aériens chargés de l’insertion et de l’extraction des forces d’opérations spéciales. Implantée à Zadar (Croatie), la structure d’entraînement a été mise en place progressivement, et les possibilités d’entraînement s’étoffent au fil du temps.
Participants : Bulgarie, Croatie, Hongrie et Slovénie.
État d’avancement : mis en place. Le centre d’entraînement pour l’aviation a ouvert ses portes officiellement le 11 décembre 2019. Les premiers stagiaires ont obtenu leur diplôme à l’issue d’un premier module de formation en octobre 2020, et plusieurs promotions se sont succédé depuis.
Initiative OTAN d’entraînement au pilotage – Europe (NFTE)

Objectif : assurer un entraînement au pilotage avec des moyens à la pointe de la technologie revient de plus en plus cher et devient de plus en plus compliqué. Pour beaucoup d’Alliés européens, l’effectif annuel des pilotes nécessaires est trop réduit pour justifier la création ou le maintien en service d’écoles de pilotage. Pour surmonter cette difficulté, l’initiative NFTE a créé, en tirant le meilleur parti possible des structures déjà en place, un réseau européen d’installations d’entraînement multinationales pour pilotes d’avions de chasse, d’hélicoptères, d’aéronefs à voilure fixe et de drones. La mise en place de l’initiative NFTE réduit sensiblement la dépendance vis-à-vis des installations d’entraînement américaines en donnant aux Alliés européens la possibilité de former leurs propres équipages dans un cadre multinational. À ce titre, l’initiative NFTE est un excellent exemple du partage des charges entre les Alliés d’Europe et d’Amérique du Nord.
Participants : Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, Macédoine du Nord, Monténégro, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Tchéquie et Türkiye.
État d’avancement : mis en place et en cours d’exécution. L’initiative NFTE a été lancée en marge du sommet de l’OTAN tenu à Bruxelles en juin 2021. À ce jour, quatorze campus d’entraînement NFTE ont été mis sur pied à travers le territoire de l’Alliance.
Environnement d’entraînement synthétique multisites
Objectif : le projet portant sur l’environnement d’entraînement synthétique multisites vise à répondre à la demande sans cesse croissante d’entraînement virtuel au niveau multinational. Il permet la mise en place d’un réseau de possibilités d’entraînement multinational avancé et immersif pour les militaires. En exploitant les capacités nationales d’entraînement simulé à des fins multinationales, le projet permettra d’obtenir des avantages opérationnels et des économies d’échelle.
Participants : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, France, Grèce, Italie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Tchéquie et Türkiye.
État d’avancement : en cours de mise en place. Le projet a été lancé en octobre 2024.
Acquisition d’équipements de haute technologie
Les équipements utilisés dans le cadre des opérations et missions de l’OTAN diffèrent par leur taille et leur coût. Si certains équipements sont peu volumineux et financièrement abordables, d’autres peuvent en revanche être trop gros ou trop onéreux pour que des pays puissent, à eux seuls, s’en servir de manière économiquement viable. Les Alliés et les pays partenaires coopèrent dans le cadre de plusieurs projets de haut niveau qu’ils ne pourraient pas mener individuellement.
Flotte d’avions multirôles de ravitaillement en vol et de transport (MRTT-C)

Objectif : le MRTT est un avion multifonction pouvant transporter du fret et des troupes, et servir au ravitaillement en vol. Les ravitailleurs en vol sont particulièrement essentiels pour la projection de la puissance aérienne. Comme ils sont mutualisés, l’interopérabilité est essentielle. Le projet MRTT-C permet aux Alliés participants d’acquérir collectivement des avions multirôles de ravitaillement en vol et de transport de type Airbus A330, afin de constituer une flotte d’appareils détenus et exploités dans un cadre multinational. L’OTAN et l’Union européenne (UE) ont uni leurs forces pour cette initiative étant donné que ces deux organisations ont recensé des insuffisances au niveau du ravitaillement en vol et que les Alliés participants sont aussi, à l’exception de la Norvège, membres de l’UE. Cette initiative est un exemple de l’étroite coopération qui existe entre l’OTAN et l’UE.
Participants : Allemagne, Belgique, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Tchéquie.
État d’avancement : mis en place et en cours d’exécution. Le premier avion a été livré en juin 2020. La flotte de MRTT a atteint sa capacité opérationnelle initiale en mars 2023. Le dernier avion devrait être livré en 2026, ce qui portera à dix le nombre total d’appareils composant la flotte.
Aéronefs maritimes multimissions (M3A)
Objectif : pour assurer la défense et la sécurité maritimes, il est essentiel que l’OTAN soit en permanence au courant de la situation et qu’elle fournisse des capacités de lutte anti-sous-marine. Un groupe d’Alliés a défini un ensemble commun de besoins dans le cadre du projet relatif aux aéronefs maritimes multimissions (M3A), qui leur servira à tous de point de départ pour les futures activités de mise en œuvre. L’Allemagne et la France ont fait un premier pas en avant en entamant la mise au point d’un système aérien de patrouille maritime (MAWS) pouvant servir d’outil pour la connaissance de la situation maritime.
Participants : Allemagne, Canada, Espagne, France, Grèce, Italie, Pologne et Türkiye.
État d’avancement : terminé. Le projet M3A a été lancé en juin 2017 et la définition des besoins a été finalisée en octobre 2018.
Systèmes maritimes sans équipage à bord (MUS)
Objectif : les systèmes sans équipage à bord sont de plus en plus importants pour l’OTAN, dans la mesure où ils renforcent la capacité de l’Alliance à répondre aux menaces dans le milieu maritime. Afin de faciliter la coopération multinationale dans ce domaine, un groupe d’Alliés et un pays partenaire ont uni leurs forces dans le cadre de l’initiative MUS afin de mettre au point des solutions adaptées, notamment des systèmes de détection et d’élimination des mines et des systèmes de suivi des sous-marins.
Participants : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Türkiye et Australie (pays partenaire).
État d’avancement : mis en place. L’initiative MUS a été lancée en octobre 2018. Depuis septembre 2019, le Portugal accueille chaque année l’exercice REPMUS, qui rassemble des pays membres et partenaires pour tester de nouveaux systèmes maritimes sans équipage à bord.
Capacité giravion de nouvelle génération (NGRC)

Objectif : les hélicoptères – ou d’une manière plus générale les moyens à décollage et atterrissage verticaux – font intégralement partie des éléments facilitateurs pour les opérations des forces de l’Alliance. Pourtant, un gros pourcentage des hélicoptères en service correspondent à des modèles introduits dans les années 1960. Pour faire en sorte que l’OTAN conserve son avance technologique dans le domaine, plusieurs Alliés se sont associés en vue de la mise au point et de l’acquisition de la prochaine génération d’hélicoptères multirôles moyens. Grâce à la NGRC, les Alliés bénéficieront de progrès non seulement au niveau de la technologie des cellules et des systèmes de propulsion (dont des solutions hybrides et électriques), mais aussi de l’infrastructure numérique des appareils, ce qui garantira la disponibilité d’hélicoptères et d’autres moyens à décollage et atterrissage verticaux pour les forces de l’Alliance dans les prochaines décennies.
Participants : Allemagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni.
État d’avancement : mis en place. La NGRC a été lancée en octobre 2020 en vue de mettre au point des hélicoptères qui devraient être mis en service entre 2035 et 2040. En octobre 2024, cinq des Alliés participants – Allemagne, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni – se sont engagés à définir une solution unique à privilégier pour le remplacement de ces capacités d’ici fin 2027, permettant ainsi la mise en place de cette solution en 2030.
Systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS)
Objectif : les systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS) – plus connus sous le nom de véhicules aériens sans équipage à bord ou drones – sont essentiels à l’exécution d’une série de missions et de rôles, dont le renseignement, la surveillance et la reconnaissance interarmées (ISR) et la guerre électromagnétique. Ce projet vise à accélérer la mise à disposition de la nouvelle génération de RPAS – comme la capacité alliée de surveillance terrestre (AGS), qui fait partie de la Force ISR de l’OTAN – grâce à une coopération multinationale.
Participants : Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Portugal, Roumanie, Tchéquie, Türkiye et Royaume-Uni.
État d’avancement : en cours de mise en place. Le RPAS a été lancé en octobre 2024.
Défense aérienne et antimissile
L’OTAN s’emploie depuis des années à renforcer ses capacités de défense aérienne et antimissile afin de protéger ses populations, son territoire et ses forces contre des menaces aériennes de plus en plus sophistiquées. Les projets suivants aident les Alliés à mettre au point de nouvelles capacités dans ce domaine.
Capacité de commandement et de contrôle pour la défense aérienne et antimissile de surface aux niveaux du bataillon et de la brigade (couche C2 pour la SBAMD)
Objectif : le projet de couche C2 pour la SBAMD doit faciliter l’acquisition et le déploiement d’une solution de gestion pour la défense aérienne, le but étant de pouvoir adopter une approche à plusieurs niveaux de la défense aérienne et antimissile de surface. La capacité de couche C2 pour la SBAMD acquise en commun réduira le nombre de systèmes actuellement utilisés par les pays de l’OTAN et augmentera donc l’interopérabilité et la résilience.
Participants : Danemark, Espagne, États-Unis, France, Hongrie, Italie, Portugal et Royaume-Uni.
État d’avancement : mis en place. Le projet de couche C2 pour la SBAMD a été lancé en octobre 2021.
Solution modulaire pour les capacités de défense aérienne basées au sol (GBAD modulaire)
Objectif : l’initiative relative à la GBAD modulaire porte sur la mise au point et l’acquisition en commun d’un système GBAD souple et modulable de lutte contre les menaces aériennes à très courte, à courte et à moyenne portée. Ce système s’articule autour d’un élément central commun de commandement et de contrôle. Grâce à sa modularité, les participants pourront définir des paquets de forces GBAD sur mesure adaptés à chaque opération.
Participants : Allemagne, Danemark, Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni et Slovénie.
État d’avancement : mis en place. L’initiative relative à la GBAD modulaire a été lancée en octobre 2020 et est actuellement au stade de conception (depuis février 2023).
Moyens rapidement déployables de lutte contre la menace roquettes-artillerie-mortiers (C-RAM)
Objectif : l’efficacité de la protection des forces alliées et des bases déployées à l’avant contre les menaces liées aux tirs de roquettes, d’artillerie et de mortiers est impérative pour garantir la disponibilité opérationnelle de l’OTAN. L’initiative C-RAM porte sur la mise au point et l’acquisition d’une capacité rapidement déployable de détection et de destruction de roquettes et d’obus d’artillerie et de mortiers dans les airs, avant qu’ils ne frappent leurs cibles. Une priorité sera tout particulièrement accordée à l’étude de solutions hautement innovantes permettant de réduire les coûts d’exploitation tout en renforçant la résilience des systèmes contre des attaques massives.
Participants : Allemagne, États-Unis, Grèce, Hongrie, Norvège, Pologne et Royaume-Uni.
État d’avancement : mis en place. L’initiative C-RAM a été lancée en octobre 2020. Ces travaux sont actuellement menés dans le cadre de l’initiative relative à la GBAD modulaire (stade de conception).
Menaces aériennes évoluant à très basse altitude
Objectif : : la guerre brutale que la Russie mène contre l’Ukraine a mis en évidence l’efficacité et la dangerosité de technologies comme celles des drones de petite taille dans un conflit. Il est essentiel pour l’Alliance d’accroître sa capacité à détecter ces nouvelles menaces, à les identifier, à les suivre et à y réagir tout en exploitant les progrès de la technologie pour renforcer son dispositif de dissuasion et de défense. Dans le cadre de cette initiative, les Alliés participants se sont engagés à mettre au point des solutions plus efficaces pour lutter contre les menaces aériennes évoluant à très basse altitude – c’est-à-dire à moins de 500 pieds/150 mètres du sol, soit à peine la hauteur d’une demi-tour Eiffel.
Participants : Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, et Türkiye.
État d’avancement : en cours de mise en place. L’initiative relative aux menaces aériennes évoluant à très basse altitude a été lancée en février 2025.
Capteurs passifs de surveillance aérienne
Objectif : la surveillance aérienne passive (détection acoustique entre autres) est essentielle pour l’identification des menaces entrantes que les moyens de surveillance aérienne active comme les radars et les satellites ne peuvent détecter. Cette initiative aidera les Alliés participants à mettre au point de nouvelles capacités de surveillance aérienne passive, lesquelles permettront d’améliorer encore la protection de leur espace aérien.
Participants : Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Tchéquie et Türkiye.
État d’avancement : en cours de mise en place. L’initiative relative à la surveillance aérienne passive a été lancée en février 2025.
Mobilité militaire et contre-mobilité
Les Alliés doivent pouvoir déplacer leurs forces avec rapidité et efficacité sur l’ensemble du territoire de l'OTAN. Ils doivent également être en mesure de freiner ou d’arrêter la progression de leurs adversaires potentiels. Plusieurs initiatives multinationales ont ainsi été lancées afin de renforcer les capacités des Alliés en termes de mobilité militaire et de contre-mobilité.
Franchissement de coupure
Objectif : le projet relatif au franchissement de coupure consiste en des activités multinationales de planification, de préparation et d’exécution en vue de la mise au point et de l’acquisition de divers moyens de pontage militaire – ponts d’assaut, ponts logistiques, systèmes de franchissement flottants ou amphibies, adaptateurs pour ponts flottants – et de solutions techniques devant permettre de mettre à niveau la capacité portante de certains ponts militaires. Il est par ailleurs envisagé, dans le cadre de ce projet, d’établir un stock multinational de ponts militaires, logistiques notamment.
Participants : Allemagne, Belgique, Croatie, Espagne, États-Unis, Finlande, Grèce, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Roumanie et Royaume-Uni.
État d’avancement : mis en place. Le projet relatif au franchissement de coupure a été lancé en février 2023.
Contre-mobilité
Objectif : le projet relatif à la contre-mobilité porte sur le développement et l’acquisition, au niveau multinational, de moyens de contre-mobilité létaux et non létaux novateurs. L’objectif est aussi de mettre sur pied un cadre permanent pour la fourniture de moyens de contre-mobilité sur le long terme, sous la forme, par exemple, d’une nouvelle association de soutien au sein de l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA).
Participants : Allemagne, Belgique, Croatie, Espagne, États-Unis, Finlande, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Roumanie et Royaume-Uni.
État d’avancement : mis en place. Le projet relatif à la contre-mobilité a été lancé en février 2023.
Véhicules et systèmes du génie militaire
Objectif : le projet relatif aux véhicules et aux systèmes du génie militaire concerne le développement et l’acquisition, au niveau multinational, de divers véhicules et systèmes du génie militaire. Un large éventail de véhicules et de systèmes sera couvert : véhicules blindés du génie, engins de bréchage, véhicules du génie autonomes ou sans équipage à bord, et charges utiles modulaires.
Participants : Allemagne, Croatie, Espagne, Grèce, Italie, Roumanie et Royaume-Uni.
État d’avancement : mis en place. Le projet relatif aux véhicules et aux systèmes du génie militaire a été lancé en février 2023.
Munitions
Les munitions sont essentielles pour toutes les opérations militaires. Pour faire en sorte que les forces des pays membres et des pays partenaires de l’OTAN soient bien équipées, plusieurs projets ont été lancés au niveau multinational.
Munitions tactiquement décisives (Air) (ABDM)
Objectif : ce projet instaure un cadre multinational pour l’acquisition de l’ensemble des munitions tactiquement décisives dans le milieu aérien. Il vise à accroître la flexibilité dans la gestion des stocks en réduisant les obstacles juridiques et techniques qui empêchent le partage et l’échange de munitions entre les Alliés participants. Cela permettra à l’Alliance de combler le déficit en matière d’interopérabilité, déficit que l’OTAN a constaté pour la première fois en 2011, lors de son opération en Libye, mais aussi d’aider les Alliés européens à réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis pour ce qui est des missions aériennes. Ce cadre a déjà permis aux participants de réaliser d’importantes économies et de gagner beaucoup de temps grâce à plusieurs séries d’acquisitions à l’échelon multinational.
Participants : Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et Tchéquie.
État d’avancement : mis en place. Le projet ABDM a été lancé par six Alliés en 2014, au sommet du pays de Galles. Les premières livraisons du premier cycle d’acquisition ont eu lieu en août 2018, et plusieurs livraisons ont suivi au fil des cycles d’acquisition successifs.
Munitions tactiquement décisives (Terre) (LBDM)
Objectif : le projet LBDM, calqué sur le projet principal présenté ci-dessus, instaure un cadre multinational pour l’acquisition de munitions pour les forces terrestres, par exemple des batteries d’artillerie de 155 mm, des missiles guidés antichars et des munitions pour char de combat. Le projet LBDM renforcera la capacité de l’Alliance à partager les munitions et à opérer de manière harmonieuse sur le terrain. Au fil du temps, cette initiative aide les troupes à accroître leur interopérabilité et leur efficacité et à harmoniser leurs stocks de munitions, et elle aide les participants à travailler ensemble de façon harmonieuse et efficace. Il rassemble actuellement 24 pays et est, de ce fait, l’un des plus importants projets à haute visibilité.
Participants : Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie et Autriche (pays partenaire).
État d’avancement : mis en place et en cours d’exécution. Le projet LBDM a été lancé en juin 2017. Les premières livraisons ont été réceptionnées en janvier 2019.
Munitions tactiquement décisives (Mer) (MBDM)
Objectif : tout comme les deux projets ci-dessus, le projet MBDM vise à regrouper les achats de munitions des Alliés participants, dans le domaine maritime cette fois. Ces achats portent sur un large éventail de munitions, dont des missiles surface-air et des missiles surface-surface, des torpilles et des obus. Ce projet marque une étape importante vers la constitution de stocks européens de munitions navales de haute qualité permettant de répondre à l’évolution des besoins de l’Alliance.
Participants : Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Pologne et Portugal.
État d’avancement : mis en place. Le projet MBDM a été lancé en juillet 2018.
Initiative pour l’entreposage multinational de munitions (MAWI)
Objectif : le stockage de munitions est un aspect essentiel de la planification des stocks de l’OTAN et un élément clé pour les opérations de l’Alliance. L’initiative MAWI définit un principe opérationnel unique en vertu duquel les participants peuvent créer et mettre en œuvre une large gamme de solutions d’entreposage. La dimension modulable, extensible et flexible donne aux pays participants la possibilité d’adapter la solution de stockage à leurs besoins, tout en bénéficiant d’une importante réduction de coûts.
Participants : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie, Türkiye – et l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA). Avec 26 pays participants, l’initiative MAWI est le plus grand projet à haute visibilité.
État d’avancement : mis en place et en cours d’exécution. L’initiative MAWI a été lancée en juillet 2021.
Essai, évaluation et certification de l’interchangeabilité des munitions de tir indirect
Objectif : l’interchangeabilité et l’interopérabilité de munitions d’artillerie clés de l’Alliance permettent aux forces armées des pays membres de l’OTAN de partager de l’artillerie et de collaborer plus aisément dans le cadre des opérations multinationales. Ce projet favorisera l’harmonisation des mécanismes nationaux d’essais de tirs et de certification pour les munitions d’artillerie. Il contribuera en outre à garder à jour les normes pertinentes et à faciliter leur adoption.
Participants : Danemark, États-Unis, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Tchéquie et Türkiye.
État d’avancement : en cours de mise en place. Le projet a été lancé en octobre 2024.
Défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN)
Les agents CBRN constituent des menaces complexes et des défis distincts pour la sécurité de l’OTAN et pour celle des Alliés. Trois projets multinationaux ont été lancés afin d’aider les Alliés à coordonner la formation, à partager l’information et à acquérir le matériel qui augmentera le niveau de préparation des forces de défense CBRN des pays de l’Alliance.
Réseau d’installations de défense CBRN
Objectif : le réseau d’installations de défense CBRN regroupe diverses installations de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) au sein d’une seule architecture. Ainsi, les capacités de ces installations – qui vont des sites d’entraînement avec agents réels aux laboratoires d’analyse – seront plus largement disponibles à l’échelle de l’Alliance.
Participants : Belgique, Espagne, Grèce et Italie, avec l’appui du cluster CBRN encadré par l’Allemagne.
État d’avancement : mis en place. Ce projet a été lancé en octobre 2021, en même temps que les deux autres initiatives dans le domaine CBRN.
Équipements de protection CBRN
Objectif : le projet relatif aux équipements de protection CBRN offre aux pays de l’OTAN qui y participent un cadre pour l’acquisition conjointe d’équipements de protection individuels et de systèmes de protection collectifs destinés à leurs unités et à leurs personnels militaires.
Participants : Albanie, Belgique, Espagne, États-Unis, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Pays-Bas et Royaume-Uni.
État d’avancement : mis en place. Ce projet a été lancé en octobre 2021, en même temps que les deux autres initiatives dans le domaine CBRN.
Détection et identification d’agents CBRN
Objectif : à l’instar du projet ci-dessus relatif à l’acquisition d’équipements de protection, le projet concernant la détection et l’identification d’agents CBRN offre aux Alliés qui y participent un cadre pour la mise au point et l’acquisition conjointes de solutions plus perfectionnées pour l’identification et la détection d’agents CBRN.
Participants : Albanie, Belgique, États-Unis, Grèce, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Pologne et Royaume-Uni.
État d’avancement : mis en place. Ce projet a été lancé en octobre 2021, en même temps que les deux autres initiatives dans le domaine CBRN.
Technologies spatiales
L’importance de l’espace pour la sécurité et la prospérité de l’Alliance va grandissant. Les informations recueillies et communiquées au moyen de satellites sont d’une importance critique pour les activités, les opérations et les missions de l’OTAN, notamment en matière de défense collective, de réponse aux crises et de lutte contre le terrorisme. Grâce aux satellites, les Alliés et l’OTAN peuvent répondre aux crises avec plus de rapidité, d’efficacité et de précision.
Capacité alliée de surveillance permanente depuis l’espace (APSS)
Objectif : la capacité alliée de surveillance permanente depuis l’espace (APSS) renforcera la coopération dans le domaine de la surveillance spatiale à l’appui de la mise en œuvre de la politique spatiale globale de l’OTAN. Les moyens spatiaux, tels que les satellites, peuvent fournir des informations en temps réel sur les mouvements des forces ennemies, sur les conditions météorologiques et le terrain, autant d’informations qui sont essentielles à la compréhension du champ de bataille et à la prise de décisions éclairées. Ce nouveau mécanisme permettra de mettre en place une constellation virtuelle à grande échelle de satellites de surveillance nationaux et commerciaux, appelée « Aquila ». Il permettra à l’Alliance de disposer plus rapidement de données de renseignement de meilleure qualité, il intégrera encore plus de données spatiales dans l’écosystème « renseignement » de l’OTAN, et il s’appuiera sur les avancées technologiques du secteur commercial. Les bases de cette initiative porteuse ont été jetées par le Luxembourg, qui a apporté l’investissement initial de 16,5 millions d’euros ; les pays participants pourront contribuer à Aquila avec leurs propres moyens, données et/ou fonds.
Participants : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Canada, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède et Türkiye.
État d’avancement : mis en place et en cours d’exécution. L’APSS a été lancée en février 2023.
NORTHLINK
Objectif : dans le cadre de NORTHLINK, les Alliés participants étudient la possibilité de mettre en place une capacité multinationale de communication par satellite dans l’Arctique qui soit sécurisée, résiliente et fiable. La militarisation accrue de la région arctique par des compétiteurs stratégiques et des adversaires potentiels est source de préoccupation pour l’Alliance. NORTHLINK vise à tirer profit des moyens spatiaux publics comme privés afin d’accroître la résilience des communications.
Participants : Allemagne, Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Suède.
État d’avancement : en cours de mise en place. Le projet NORTHLINK a été lancé en octobre 2024.
STARLIFT
Objectif : dans le cadre de STARLIFT, les Alliés participants étudient des moyens de renforcer l’accès de l’OTAN à l’espace et l’utilisation de celui-ci par l’Organisation pour faire face à une série de défis. STARLIFT vise à développer un réseau de capacités de lancement qui pourra aider les Alliés à lancer des moyens spatiaux sur court préavis depuis des ports spatiaux situés dans différents pays de l’Alliance, permettant à l’OTAN de répondre plus rapidement aux menaces spatiales. Dans le cadre de ce projet, les Alliés étudieront également la possibilité de manœuvrer un engin spatial prépositionné en réserve ou d’acheter des données à des partenaires commerciaux en cas de crise ou de conflit.
Participants : Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Türkiye.
État d’avancement : en cours de mise en place. Le projet STARLIFT a été lancé en octobre 2024.
Fonctionnement
Les Alliés n’ont de cesse d’envisager de nouvelles initiatives multinationales qui permettraient de mettre au point, en exploitant au mieux les sources de financement disponibles, les capacités dont l’Alliance a besoin pour faire face aux défis de sécurité actuels.
Ainsi, les projets OTAN à haute visibilité (HVP) ont essentiellement pour objet d’accélérer la fourniture des capacités les plus critiques. Les engagements politiques dont ils résultent sont formalisés par des accords signés par les ministres de la Défense. Un premier document, appelé « lettre d’intention » – exposant les principes généraux de la coopération –, est signé par les ministres de la Défense des pays associés au projet. Un mémorandum d’entente (MOU), un document juridiquement contraignant présentant les détails de la coopération, est ensuite signé. Cet instrument fournit le cadre juridique nécessaire à l’exécution de la phase de mise en œuvre, qui débouchera sur la fourniture de la capacité concernée. Le fait d’associer au processus des responsables politiques de haut niveau améliore considérablement les perspectives de résultats rapides et concrets.
Dans la phase de mise en œuvre de la plupart des projets, l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA) joue le rôle d’intermédiaire entre les pays et l’industrie. Elle peut intervenir à différents niveaux : elle peut inviter l’industrie à présenter aux Alliés et aux partenaires des solutions à acquérir, être associée au processus d’acquisition, ou même négocier avec l’industrie pour le compte des pays.
La Conférence des directeurs nationaux des armements (CDNA) – le haut comité de l’OTAN qui réunit les hauts responsables nationaux chargés des acquisitions pour la défense dans les pays de l’OTAN et les pays partenaires – joue également un rôle dans la coopération capacitaire multinationale. Il lui incombe de recenser les possibilités de coopération dans le domaine de la recherche, du développement et de la production d’équipements militaires et de systèmes d’armes, et elle a la responsabilité d’un certain nombre de projets de coopération en matière d’armements qui ont pour but de doter les forces de l’OTAN de capacités de pointe.