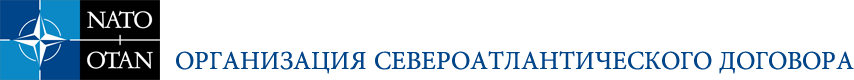Le Partenariat pour la paix
Le Partenariat pour la paix (PPP) est un programme de coopération bilatérale entre l’OTAN et des partenaires de la région euro-atlantique. Il permet à ces derniers de développer une relation avec l’OTAN, en fixant leurs propres priorités en matière de coopération.

- Fondé sur un attachement aux principes démocratiques, le PPP vise à renforcer la stabilité, à réduire les menaces pesant sur la paix, et à consolider les relations de sécurité entre les Alliés et les pays de la zone euro-atlantique qui ne sont pas membres de l’OTAN.
- Le PPP a été créé en 1994 afin de permettre aux pays participants d’établir une relation avec l’OTAN, en fixant leurs propres priorités en matière de coopération et en définissant les progrès qu’ils souhaitent accomplir, et à quel rythme.
- Les activités proposées dans le cadre du PPP se rapportent à pratiquement tous les domaines d’action de l’OTAN.
- Depuis avril 2011, l’ensemble des activités et exercices organisés dans le cadre du PPP sont en principe ouverts à tous les partenaires de l’OTAN, qu’il s’agisse des pays de la région euro-atlantique, de ceux du Dialogue méditerranéen ou de l’Initiative de coopération d’Istanbul, ou encore des partenaires mondiaux.
- Les différents axes de la collaboration entre l’OTAN et le partenaire sont présentés dans un programme de partenariat individualisé (ITPP).
Une vaste gamme d'activités, d'outils et de programmes
Les activités proposées dans le cadre du PPP se rapportent à pratiquement tous les domaines d’action de l’OTAN : questions de défense (réforme de la défense, politique et plans de défense, etc.), relations civilo-militaires, formation et entraînement, coopération entre militaires et exercices, réponse aux situations d’urgence civile, ou encore coopération sur les plans scientifique et environnemental.
Au fil du temps, différents outils et mécanismes ont été mis au point pour soutenir la coopération au travers d’une variété de politiques, de programmes, de plans d’action et d’arrangements. Au sommet de Lisbonne, en novembre 2010, dans le cadre d’un effort ciblé de réforme visant à élaborer une politique de partenariat plus efficace et plus souple, les dirigeants des pays de l’Alliance ont décidé de rationaliser les outils de partenariat de l’OTAN afin d’ouvrir aux partenaires l’ensemble des activités et exercices proposés dans le cadre de la coopération et d’harmoniser les programmes de partenariat.
La politique de partenariat approuvée par les ministres des Affaires étrangères des pays de l’Alliance à Berlin, en avril 2011, a permis à tous les partenaires, qu’il s’agisse de partenaires euro-atlantiques, de pays du Dialogue méditerranéen ou de l’Initiative de coopération d’Istanbul, ou encore de partenaires mondiaux, d’accéder à l’ensemble des activités de coopération et exercices qui étaient auparavant destinés exclusivement aux partenaires participant au PPP, ainsi qu’à certains programmes leur étant réservés (pour de plus amples informations, consulter l’article « Programmes et outils de partenariat ».)
Le Conseil de partenariat euro-atlantique constitue le cadre politique global dans lequel s’inscrit la coopération entre l’OTAN et les partenaires euro-atlantiques participant au PPP.
Liste des pays du Partenariat pour la paix.
Cadre général
Les programmes de partenariat individualisés (ITPP) sont établis d’un commun accord par l’OTAN et les pays partenaires. Couvrant une période de quatre ans, l’ITPP présente les différents axes de la collaboration entre l’OTAN et le partenaire et en définit les objectifs stratégiques et les buts concrets. Tous les partenaires ont accès au menu de coopération partenariale, qui comprend quelque 1 400 activités.
L’ITPP réunit dans un même cadre tous les mécanismes de coopération dont bénéficie le partenaire.
Chronologie
-
afficher la chronologie
Juillet 1990 : Les Alliés tendent la « main de l’amitié » par-delà l’ancienne ligne de division entre l’Est et l’Ouest, et proposent une nouvelle relation de coopération avec tous les pays d’Europe centrale et orientale.
Novembre 1991 : L’OTAN adopte un nouveau concept stratégique, reflet d’une conception élargie de la sécurité, qui met l’accent sur le partenariat, le dialogue et la coopération.
Décembre 1991 : Création du Conseil de coopération nord-atlantique (CCNA), forum pour le dialogue sur la sécurité entre l’OTAN et ses nouveaux partenaires.
1994 : Lancement du Partenariat pour la paix (PPP), cadre de coopération pratique bilatérale entre l’OTAN et les pays participants. Ouverture de missions des pays partenaires auprès de l’OTAN. Mise en place de la Cellule de coordination du Partenariat au Grand quartier général des puissances alliées en Europe (SHAPE) pour aider à la coordination des activités de formation et des exercices proposés dans le cadre du PPP.
1995 : Création, au SHAPE, du Centre de coordination internationale, qui offre aux pays non OTAN fournissant des troupes pour les opérations de maintien de la paix dirigées par l’Alliance un cadre dans lequel ils peuvent échanger des informations et effectuer un travail de planification.
1996 : Plusieurs pays partenaires déploient des troupes en Bosnie-Herzégovine dans le cadre de la force de maintien de la paix dirigée par l’OTAN.
1997 : Création du Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA), qui remplace le CCNA.
Juillet 1997 : Au sommet de Madrid, les Alliés décident de renforcer le rôle opérationnel du PPP.
1998 : Création du Centre euro-atlantique de coordination des interventions en cas de catastrophe et de l’Unité euro-atlantique d’intervention en cas de catastrophe.
1999 : La Hongrie, la Pologne et la Tchéquie, jusque-là pays partenaires, deviennent membres de l’OTAN.
Avril 1999 : Au sommet de Washington, l’OTAN se dote d’un nouveau concept stratégique, qui fait figurer le dialogue et la coopération au rang des tâches de sécurité fondamentales de l’Alliance. Par ailleurs, le PPP est étendu et son rôle opérationnel renforcé, grâce notamment :
- à l’adoption du concept de capacités opérationnelles, visant à améliorer l’aptitude des forces des pays de l’Alliance et des pays partenaires à participer ensemble à des opérations dirigées par l’OTAN ;
- à l’établissement du cadre politico-militaire régissant la participation des partenaires aux consultations politiques et au processus décisionnel, à la planification opérationnelle et aux dispositions de commandement ;
- à la création du programme de renforcement de la formation et de l’entraînement PPP, destiné à contribuer à l’amélioration des capacités opérationnelles des partenaires.
1999 : Plusieurs pays partenaires déploient des soldats de la paix dans le cadre de la force de maintien de la paix dirigée par l’OTAN au Kosovo (KFOR).
12 septembre 2001 : A lendemain des attentats terroristes du 11‑Septembre aux États-Unis, le CPEA se réunit et s’engage à lutter contre le fléau du terrorisme.
2002 : La politique des fonds d’affectation spéciale du PPP est mise en place. Elle a pour objet d’aider les partenaires à détruire en toute sécurité leurs stocks de mines antipersonnel et de munitions.
Novembre 2002 : Au sommet de Prague, le renforcement des partenariats se poursuit :
- il est procédé à un réexamen d’ensemble pour approfondir le dialogue politique avec les partenaires et les associer davantage à la planification, à la conduite et à la supervision des activités auxquelles ils participent ;
- un plan d’action du Partenariat contre le terrorisme (PAP-T) est adopté ;
- le principe des plans d’action individuels pour le partenariat est approuvé ; il permet à l’Alliance d’adapter son aide aux besoins des partenaires qui souhaitent bénéficier d’un soutien plus structuré pour l’exécution de réformes internes, en particulier dans le secteur de la défense et de la sécurité.
2003 : Plusieurs pays partenaires fournissent des troupes à la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) dirigée par l’OTAN en Afghanistan.
2004 : La Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, jusque-là pays partenaires, deviennent membres de l’OTAN.
Juin 2004 : Au sommet d’Istanbul, de nouvelles mesures sont prises pour renforcer le PPP :
- un plan d’action du Partenariat pour l’établissement d’institutions de défense (PAP-DIB) est approuvé ; il s’agit d’encourager et d’aider les partenaires à mettre en place des institutions de défense efficaces, contrôlées démocratiquement ;
- le concept de capacités opérationnelles est renforcé et les partenaires se voient offrir une représentation au sein du Commandement allié Transformation, l’objectif étant d’accroître l’interopérabilité militaire entre leurs forces et celles des pays de l’OTAN;
- une attention particulière est portée aux régions du Caucase et de l’Asie centrale.
2006 : La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie accèdent au statut de partenaires.
Avril 2008 : Au sommet de Bucarest, Malte reprend sa participation au PPP (qu’elle avait suspendue en octobre 1996, après s’être associée à l’initiative en avril 1995) et devient membre du CPEA. Par ailleurs, priorité est donnée à la coopération avec les partenaires pour le développement de l’intégrité au sein des institutions de défense, et le rôle important des femmes dans le règlement des conflits est souligné, en référence à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU.
2009 : L’Albanie et la Croatie, jusque-là pays partenaires, deviennent membres de l’OTAN.
Novembre 2010 : Au sommet de Lisbonne, les Alliés réitèrent leur engagement en faveur du CPEA et du PPP. Le concept stratégique de l’OTAN adopté à cette même occasion place ces cadres de coopération au cœur de la vision des Alliés, celle d’une Europe entière, libre et en paix. Les Alliés décident de rationaliser les outils de partenariat de l’OTAN afin d’ouvrir à tous les partenaires l’ensemble des activités et exercices proposés dans le cadre de la coopération et d’harmoniser les partenariats. Ils décident également de réexaminer le cadre politico-militaire pour les opérations PPP dirigées par l’OTAN, afin de repenser la manière dont l’OTAN travaille avec les pays partenaires et élabore avec eux les décisions concernant les opérations et les missions auxquelles ils contribuent.
Avril 2011 : Suite aux décisions prises au sommet de Lisbonne, les ministres des Affaires étrangères des pays de l’Alliance, réunis à Berlin, approuvent une nouvelle politique de partenariat, plus efficace et plus souple, et prennent note du nouveau cadre politico-militaire pour la participation des partenaires aux opérations dirigées par l’OTAN.
Janvier 2014 : Le PPP célèbre ses 20 ans.
Juillet 2016 : Au sommet de Varsovie, les dirigeants des pays de l’Alliance déclarent que, face à un environnement de sécurité mondial de plus en plus instable, et sur la base d’une posture de dissuasion et de défense large et renforcée, l’OTAN s’emploiera à contribuer davantage à l’action de la communauté internationale visant à projeter la stabilité et à renforcer la sécurité hors du territoire de ses pays membres, contribuant ainsi à la sécurité générale de l’Alliance. Dans le cadre de ces efforts, l’OTAN entend développer une approche plus stratégique, plus cohérente et plus efficace des partenariats.
Juin 2017 : Le Monténégro, jusque-là pays partenaire, devient membre de l’OTAN.
Mars 2020 : La Macédoine du Nord, jusque-là pays partenaire, devient membre de l’OTAN.
Avril 2023 : La Finlande, jusque-là pays partenaire, devient membre de l’OTAN.
Mars 2024 : La Suède, jusque-là pays partenaire, devient membre de l’OTAN.