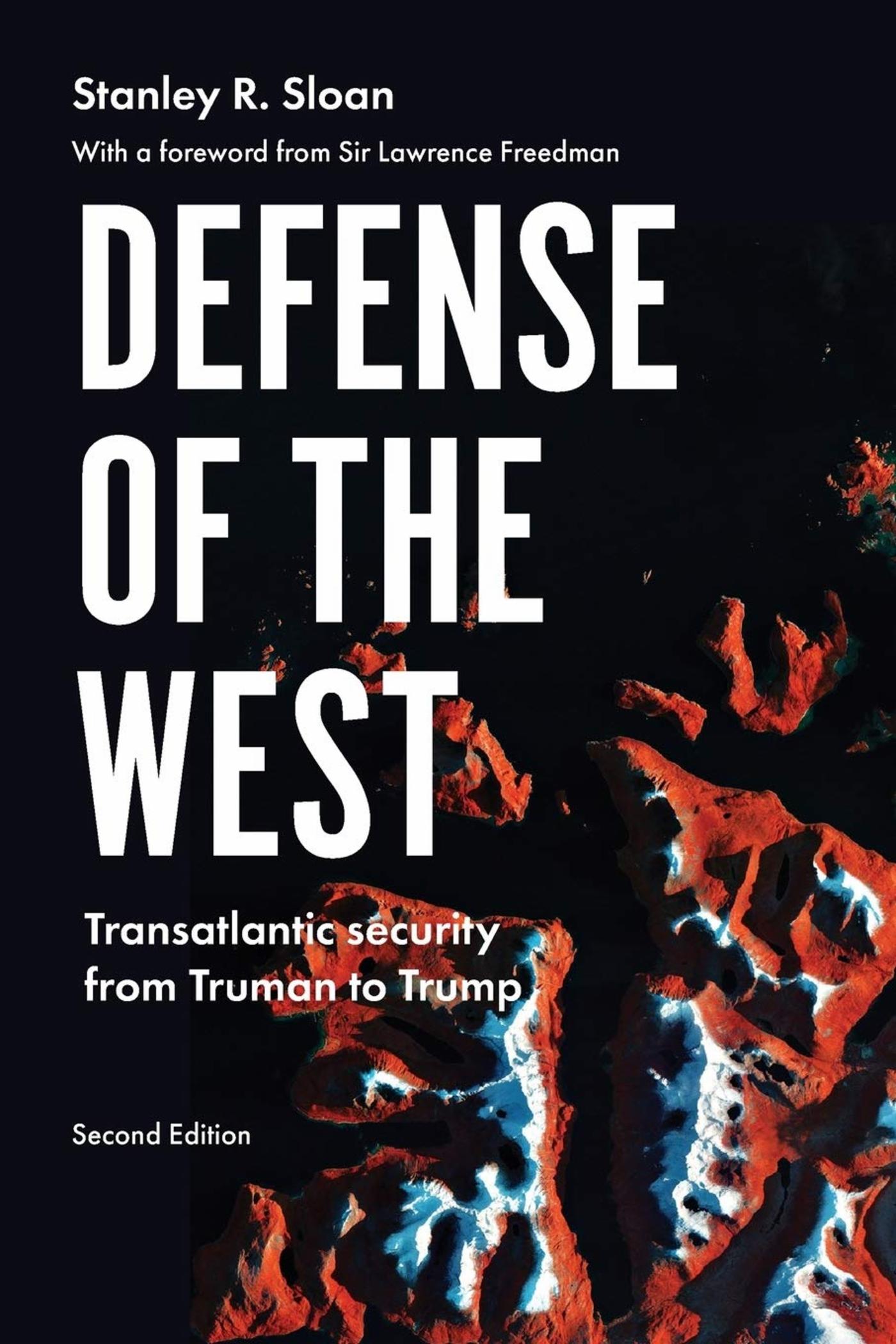Depuis des dizaines d’années, Stanley Sloan fait partie des quelques observateurs de l’OTAN qui publient des ouvrages éminemment lisibles sur les origines de l’Alliance et sur son avenir. Selon l’historien américain Lawrence Kaplan, Stanley Sloan est « l’autorité américaine la plus importante en ce qui concerne l’étude de l’histoire de l’OTAN ».
Pendant 25 ans, Stanley Sloan a travaillé pour le service de recherche du Congrès américain, où il était spécialiste principal en matière de politique de sécurité internationale. Ses travaux au sein du Congrès, de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, et du Groupe d’observateurs du Sénat pour les activités de l’OTAN font de lui un observateur avisé des questions de sécurité transatlantique. Stanley Sloan a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles, et il a pris la parole en public à maintes reprises des deux côtés de l’Atlantique, devenant ainsi l’éminence grise des affaires de l’OTAN.
Il y a quelques années, la revue de l’OTAN livrait une [analyse de « Defense of the West »].(https://www.nato.int/docu/review/fr/articles/2017/04/27/a-lire-deux-ouvrages-serieux-sur-lotan/index.html) La deuxième édition de ce livre mérite, elle aussi, d’être commentée. Pour comprendre pourquoi, il faut comparer les sous-titres des deux éditions. Celui de la première est « L’OTAN, l’Union européenne et la donne transatlantique » (« NATO, the European Union and the transatlantic bargain »). Le sous-titre de la deuxième édition est bien différent : « La sécurité transatlantique de Truman à Trump » (« Transatlantic security from Truman to Trump »). Le lecteur aura deviné la raison de cette modification. Dans la deuxième édition de son livre, Stanley Sloan fait le point sur la présidence de Donald Trump, qui a posé des défis sans précédent à l’OTAN. Étant donné que la majeure partie de l’ouvrage est presque identique à l’édition précédente, la présente analyse est surtout axée sur les éléments nouveaux.
« Defense of the West » est le cinquième livre d’une série entamée en 1984, avec la publication de « NATO’s Future: Towards a New Transatlantic Bargain » (« L’avenir de l’OTAN : vers une nouvelle donne transatlantique »). Concrètement, dans cet ouvrage et dans de nombreux autres publiés par la suite, Stanley Sloan prend comme point de départ la description de l’OTAN donnée par l’ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l’Organisation, Harlan Cleveland, qui parle de la « donne transatlantique ». Il s’agissait alors de l’engagement des États-Unis à reconstruire l’Europe occidentale, ravagée par la Seconde Guerre mondiale, en échange de quoi l’Europe s’organiserait progressivement pour assurer sa propre défense. Harlan Cleveland était d’avis que cet accord fonctionnait car il s’inscrivait « dans un cadre d’intérêt commun, perçu et reconnu ». L’homme politique se disait conscient du fait que les problèmes de partage des charges resteraient difficiles à résoudre, qualifiant même l’OTAN de « polémique organisée à propos de qui va fournir quel effort », tout en soulignant que « peu importe à quel point la donne change, il existe une constante, le consensus entre les Alliés sur le fait qu’il en faut une ».
Aux yeux de Stanley Sloan, dans une nouvelle donne transatlantique, les Européens auraient davantage de responsabilités et l’Amérique du Nord continuerait de jouer un rôle dans les affaires de sécurité européennes. Un tel changement de donne ne se fera pas du jour au lendemain, et il ne suffit pas de comparer les dépenses de défense pour s’en rendre compte. Ce constat devient clair dans la partie principale du livre, où l’auteur, bien documenté, retrace l’histoire de l’OTAN. À l’opposé, dans la vision transactionnelle qu’a Donald Trump de l’OTAN, la donne transatlantique est limitée à un simple accord commercial – qui est, de surcroît, une mauvaise affaire, les Européens jouant les passagers clandestins aux frais du contribuable américain, selon l’ancien président. Stanley Sloan convient que de nombreux Alliés n’ont pas investi autant dans la défense qu’ils auraient dû. Cependant, l’insistance de Donald Trump à affirmer que les Alliés devaient des « arriérés » aux États-Unis n’était, comme le relève Stanley Sloan, « en rien conforme aux dispositions du Traité de l’Atlantique Nord et à la pratique des Alliés pendant les 70 dernières années ». L’auteur replace la « perturbation Trump » dans un contexte plus large : la montée de « l’illibéralisme » et du populisme dans de nombreux pays occidentaux, la crise financière mondiale, et le « choc du Brexit » ont douché l’optimisme de l’Occident quant à l’attrait de son propre modèle politique et économique. Stanley Sloan montre clairement que la montée en puissance de Donald Trump sur la scène politique n’est pas un fait isolé. Néanmoins, avec son style personnel, unique en son genre, l’ancien président des États-Unis a mis l’OTAN face à une difficulté de taille.
Tandis qu’il ne manquait pas une occasion de faire le procès de l’OTAN, il a refusé de critiquer la Russie et son agression à l’encontre de l’Ukraine. Au sommet tenu à Bruxelles en mai 2017, Donald Trump a évité toute référence directe à l’article 5 du traité de Washington, d’une importance cruciale car il prévoit l’obligation de venir en aide à tout Allié victime d’une attaque. Quelques semaines plus tard, dans un discours prononcé à Varsovie, le président s’est finalement dit attaché à l’article 5, mais le mal était fait. Les États-Unis paraissaient résolus à abandonner leur poste aux commandes de l’Alliance occidentale.
Stanley Sloan loue le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, pour avoir « délibérément adopté une stratégie consistant à n’avoir de cesse de complimenter les Alliés pour leurs réalisations, (...) de les prier instamment d’en faire davantage, et de remercier le président Trump d’avoir permis de réaliser des avancées, quelles qu’elles soient ». Le talent avec lequel le secrétaire général a géré le président des États-Unis n’est pas passé inaperçu. Il a été invité à prononcer un discours devant les deux chambres du Congrès des États-Unis réunies en session conjointe – devenant le tout premier dirigeant d’une organisation internationale à s’exprimer dans un tel cadre. Cette invitation prouve que malgré la manie de Donald Trump d’avoir recours à l’unilatéralisme, des États-Unis différents, multilatéraux, existaient encore.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg a prononcé un discours devant les deux chambres du Congrès des États-Unis, le mercredi 3 avril 2019 à Washington, devenant ainsi le tout premier dirigeant d’une organisation internationale à s’exprimer dans un tel cadre. © OTAN
Stanley Sloan soutient d’un ton sarcastique que Donald Trump a contribué à unifier les Européens, mais il ajoute qu’ils « sont en grande partie unis contre les États-Unis, plutôt que derrière eux ». Alors qu’il admet que Donald Trump (et le Brexit) ont poussé l’Union européenne (UE) à approuver plusieurs mesures pour une coopération plus étroite dans le domaine de la sécurité, l’auteur estime que ces mesures ne s’inscrivent pas tellement dans la logique d’une nouvelle donne transatlantique, mais qu’elles sont plutôt le reflet d’un scepticisme quant à l’avenir de cette donne. Ajoutant à cela le déclin dont l’image publique des États-Unis a souffert partout dans le monde pendant la présidence de Donald Trump, Stanley Sloan se demande avec inquiétude si les dégâts causés ne sont pas irréparables. Il conclut son analyse des années Trump avec un verdict sans équivoque : « Tout compte fait, en 2020, Donald Trump en avait fait davantage pour affaiblir le rôle de son pays comme chef de file de l’Occident (...) que ce que même ses critiques les plus sévères n’avaient présagé avant son investiture. »
Voilà où on en était en 2020. Et maintenant ? L’administration Biden, qui a pris ses fonctions après la publication de l’ouvrage de Stanley Sloan, peut-elle réparer les dommages causés à la relation transatlantique ? Dans la dernière partie du livre, où l’auteur présente les nombreux défis externes et internes auxquels l’Occident est confronté, il devient évident que pour faire face à ces défis, il faudra bien plus qu’un gouvernement américain plus enclin à coopérer et plus conciliant. Les défis externes recensés sont une Russie révisionniste, les conflits et l’instabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la fragilité persistante de l’Afghanistan, la prolifération des armes de destruction massive, les cybermenaces, les guerres de l’information, et le défi que représente la Chine. Les difficultés liées à la pandémie et à l’environnement sont également mentionnées, mais brièvement.
Quant aux défis internes, Stanley Sloan évoque en premier lieu l’ambivalence autour de l’avenir du rôle moteur des États-Unis. L’écrivain note avec préoccupation que la polarisation d’un « système politique américain dysfonctionnel » ne créera pas la continuité politique dont Washington a besoin s’il veut être un véritable leader. Les autres défis internes présentés sont l’insuffisance des dépenses de défense européennes, les vulnérabilités économiques et politiques de l’Europe, et le manque de coopération entre l’OTAN et l’UE. Ce dernier élément est particulièrement cher à Stanley Sloan. S’il a abandonné son idée d’un « traité de la communauté atlantique », dont le but aurait été de rassembler tous les États membres de l’OTAN et de l’UE dans un seul cadre pour promouvoir leur unité, Stanley Sloan dit réaliser que l’approche globale nécessaire pour faire face aux défis de sécurité modernes requiert une plus grande coopération entre l’OTAN et l’UE. Une telle coopération serait axée « sur les menaces extérieures pour la sécurité et les valeurs transatlantiques, plutôt que sur des philosophies et des structures organisationnelles contradictoires ».
Dans l’ensemble, si l’on compare cet ouvrage à ses publications précédentes, Stanley Sloan se montre plus pessimiste quant à l’avenir de la relation transatlantique dans le domaine de la sécurité. Ceci est dû, entre autres, au choc causé par le président Trump, qui a parfois semblé vouloir aller jusqu’à faire sortir les États-Unis de l’OTAN. En outre, Stanley Sloan est préoccupé par l’approche de l’Occident, qui, d’une manière plus générale, n’est pas sur la bonne voie, notamment lorsqu’il ne défend pas ses valeurs. Il écrit que « l’avenir de l’Occident se résume peut-être à un choix fondamental : les États-Unis et leurs partenaires européens doivent-ils se plier aux exigences géopolitiques russes concernant la création d’une zone tampon entre la cleptocratie de Poutine et l’Occident démocratique (...) ou doivent-ils défendre, tant en actes qu’en paroles, les valeurs libérales dont ils ont espéré qu’elles façonneraient l’Europe après la fin de la Guerre froide ? » La réponse que Stanley Sloan apporterait à cette question ne laisse planer aucun doute, mais l’auteur indique ne pas être certain de la manière dont certaines démocraties occidentales, repliées sur elles-mêmes, y répondraient.
Ce livre, de même que sa version précédente, est clairement destiné à un public « étudiants », comme l’atteste la rubrique « questions à débattre » qui clôt chaque chapitre. Il est par ailleurs exhaustif, ce qui est également une faiblesse. En effet, les répétitions sont nombreuses, et tandis que certains points sont abordés en détail, d’autres sont à peine effleurés, comme si l’auteur n’avait pas eu le temps de les analyser plus en profondeur. « Defense of the West » n’en demeure pas moins un ouvrage impressionnant : il retrace l’histoire de l’OTAN de manière bien documentée et sans avoir recours au jargon du domaine, et il contient les réflexions presque philosophiques d’un observateur avisé de la communauté transatlantique.