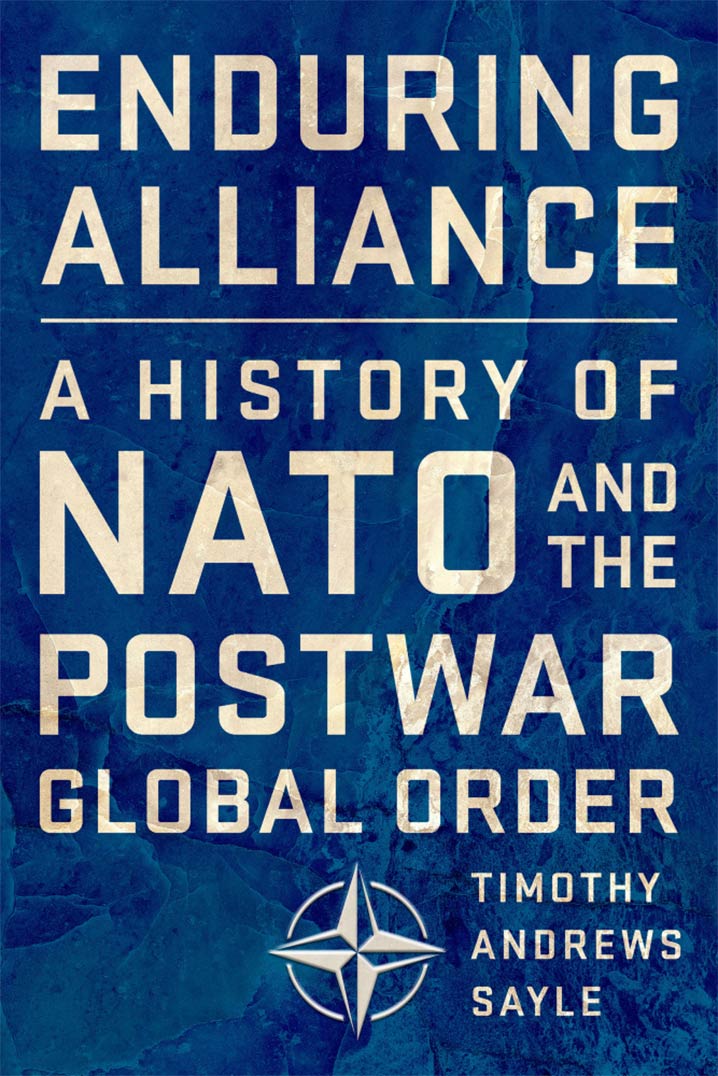Dans son excellent ouvrage intitulé Enduring Alliance: A History of NATO and the Postwar Global Order, Timothy Andrews Sayle, chargé de cours en histoire à l’Université de Toronto, relate la fascinante histoire du transatlantisme.
L’auteur consacre la majeure partie de son propos à la phase de formation de l’Alliance atlantique, de la fin des années 1940 au début des années 1950, en soulignant le désir sincère des dirigeants occidentaux, dont bon nombre avaient connu deux guerres mondiales, d’éviter une nouvelle conflagration militaire en Europe. Il fait remarquer qu’au lendemain de la guerre, les sociétés ouest-européennes, affaiblies par le conflit, craignaient moins les chars l’Armée rouge que la menace de subversion russe, et que dans ce contexte, l’OTAN était non seulement un rempart militaire contre une invasion soviétique mais également un moyen d’apporter à l’Europe occidentale l’assurance dont elle avait besoin pour résister à la « tactique du salami » déployée par Moscou pour monter les États les uns contre les autres.
L’Alliance a été fondée à une époque où les empires existaient encore, et Sayle démontre avec brio que la France et le Royaume-Uni ont tenté – en vain – d’utiliser l’OTAN pour freiner l’effondrement de leurs régimes coloniaux. C’est ainsi qu’initialement, le traité de Washington, document fondateur de l’OTAN, incluait les départements français d’Algérie. Quelques années plus tard, lors de la crise du canal du Suez, la France et le Royaume-Uni se sont retrouvés à couteaux tirés avec les États-Unis. Ces derniers, fermement convaincus que l’ère des empires était révolue, martelaient que l’Alliance ne pouvait donner l’impression de défendre une idée à laquelle presque tout le reste du monde était hostile. Il est d’ailleurs intéressant de constater que dix ans plus tard, lorsque les Américains ont sollicité un soutien au Viet Nam, les Alliés européens avaient perdu toute envie de faire intervenir l’OTAN en dehors de ses frontières européennes.
Sayle décrit fort bien l’exercice d’équilibrisme auquel s’adonnait constamment le Royaume-Uni, qui a toujours cherché à rester « l’Allié numéro un » des États-Unis tout en s’efforçant d'obtenir les avantages de la Communauté économique européenne. Il détaille également les contrariétés provoquées par le général De Gaulle, qui, alors qu’il honnissait l’OTAN, voulait que celle-ci appuie la France dans ses affaires coloniales en Afrique du Nord. L’homme d’État s’était également prononcé en faveur d’une Alliance emmenée par un triumvirat composé de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, ce qui ne l’a pas empêché d’opposer son veto à la première demande d’adhésion de la Grande-Bretagne à la Communauté économique européenne ni de retirer la France du commandement militaire intégré de l’OTAN en 1966. Après l’apaisement des tensions de la Guerre froide qui avait suivi la résolution de la crise des missiles cubains, De Gaulle estimait que son pays n’avait plus besoin de la protection des États-Unis. C’est à ce moment que la République fédérale d’Allemagne a commencé à jouer un rôle plus assertif au sein de l’Alliance, éveillant chez certains membres des sentiments contradictoires : les craintes que les Allemands de l’Ouest n’élisent un gouvernement revanchard et ne tentent d’obtenir l’arme nucléaire alternaient avec celles de voir Bonn se rapprocher de Moscou au détriment de l’unité des Alliés.
Sayle affirme par ailleurs qu’aux yeux de ses dirigeants, l’Alliance avait non un mais deux adversaires : outre Moscou, bien sûr, il fallait en effet composer avec l’électorat des pays occidentaux, qui représentait, selon l’auteur, la plus grande menace pour l’existence de l’OTAN. Les dirigeants transatlantiques appréhendaient constamment de voir les populations des pays membres retirer leur soutien à l’Alliance et d’être poussés par les urnes à adopter des politiques nuisibles à la cohésion occidentale. En un mot comme en cent, le plus grand danger pour l’équilibre des forces en Europe n’était pas une invasion soviétique mais le glissement des lignes de force politiques.
Le rapport Harmel est tout juste parvenu à donner aux politiciens occidentaux un nouvel argument en faveur de l’OTAN et des budgets de défense demandés aux pays de l’Alliance, à une époque où les espoirs suscités par la Détente faisaient apparaître ces dépenses comme des futilités.
À cela s’ajoutait la crainte que la croissance du poids économique de l’Europe occidentale, symbolisée par l’essor de la Communauté européenne, ne provoque des différends commerciaux avec les États-Unis, ce qui aurait pu pousser le Congrès américain à réagir en limitant l’engagement du pays vis-à-vis de l’Alliance. Il semblait donc qu’à chaque fois que la sécurité de l’Europe se renforçait, l’avenir de l’OTAN s’assombrissait. Même le rapport Harmel, publié en 1967 et souvent présenté aujourd’hui comme un coup de maître diplomatique qui a permis à l’Alliance de conserver sa pertinence alors que les tensions entre l’Est et l’Ouest paraissaient se relâcher, n’a pas été la panacée que l’on escomptait. Selon Sayle, il est tout juste parvenu à donner aux politiciens occidentaux un nouvel argument en faveur de l’OTAN et des budgets de défense demandés aux pays de l’Alliance, à une époque où les espoirs suscités par la Détente faisaient apparaître ces dépenses comme des futilités. Le livre regorge d’observations telles que celles-ci, à la fois brèves et pleines de lucidité.
Les tentatives alliées de contrer la montée en puissance de l’appareil militaire soviétique dans les années 1970, illustrée notamment par le déploiement de missiles balistiques de portée intermédiaire SS-20 par Moscou, ont donné lieu à l’une des plus graves crises de l’histoire de l’OTAN. Toujours inquiets à l’idée d’être « dissociés » des États-Unis, les Européens ont exigé une réponse de l’Alliance, mais quand Washington a suggéré le déploiement de nouvelles armes nucléaires en Europe, certains Alliés parmi ceux-là mêmes qui avaient demandé une réaction se sont mis à hésiter. Mis sous pression par un mouvement pacifiste en pleine expansion et par une vaste entreprise de propagande soviétique, les gouvernements européens se sont retrouvés tiraillés entre la nécessité d’affirmer leur solidarité transatlantique et celle d’éviter de heurter les sensibilités politiques dans leur pays. Comme le montre Sayle, les armes nucléaires représentaient pour l’OTAN à la fois une force (sur le plan militaire) et une faiblesse (sur le plan politique).
Le récit que l’auteur nous livre des négociations sur l’accession de l’Allemagne réunifiée à l’OTAN illustre bien le rôle critique qu’ont joué les États-Unis dans la gestion de la transition pacifique en Europe. Comme il l’indique sans ambages, « l’avenir de l’OTAN à la fin de la Guerre froide a essentiellement été façonné par les États-Unis et les autres grands pays de l’Alliance ». Il montre également que les dirigeants occidentaux ont recommencé à s’inquiéter du désintérêt du public à l’égard de l’Organisation : lorsqu’on lui a demandé qui était désormais l’ennemi, le président George H. W. Bush a répondu « l’apathie et l’imprévisibilité ». Une fois encore, l’Alliance semblait victime de son propre succès. Elle a pourtant persévéré.
Les dirigeants occidentaux ont recommencé à s’inquiéter du désintérêt du public à l’égard de l’Organisation : lorsqu’on lui a demandé qui était désormais l’ennemi, le président George H. W. Bush a répondu « l’apathie et l’imprévisibilité »
Dans la mesure où Sayle se concentre principalement sur les premières années de l’Alliance, il donne beaucoup moins de détails sur la phase d’adaptation de l’OTAN à l’après-Guerre froide. Mais même là, quand il survole en quelques pages à peine les interventions militaires dans les Balkans et en Afghanistan ainsi que l’élargissement à l’Est, il parvient à nous faire part de perspectives intéressantes.
Tout au long de son ouvrage, il démontre que Washington n’a jamais cessé de pousser l’OTAN à s’adapter pour survivre. Pour le département d’État, en particulier, l’Alliance était plus qu’un simple bastion associé à la Guerre froide : c’était un cadre destiné à assurer la stabilité de l’Europe et à maintenir entre les forces en présence un équilibre favorisant les États-Unis. Les dirigeants de la première génération craignaient également que leurs successeurs ne saisissent pas la véritable importance de l’OTAN. Dans le même temps, certains atlantistes convaincus, tels que le secrétaire d’État américain Henry Kissinger, s’en sont servis éhontément pour faire pression sur les Alliés européens lorsque ceux-ci semblaient agir à l’encontre des intérêts des États-Unis.
Sayle souligne par ailleurs les limites du rôle de secrétaire général de l’OTAN : dans une Alliance composée d’États-nations souverains, celui-ci est davantage secrétaire que général, et s’il a parfois l’occasion d’agir de sa propre initiative, il est le plus souvent l’exécutant des décisions prises par les Alliés.
L’auteur avance en outre que le commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) a beau être un officier américain de haut rang et respecté, c’est au final le président des États-Unis qui prend les décisions liées aux questions militaires fondamentales. Il donne d’ailleurs plusieurs exemples convaincants de situations où Washington a « piloté » le SACEUR pour imposer ses vues au sein de l’OTAN, voire pour contourner purement et simplement l’Alliance – comme ce fut le cas avec la constitution de Live Oak, le groupe chargé de concevoir les plans de défense de Berlin-Ouest. À la lecture du récit de Sayle, le général Dwight D. Eisenhower, premier SACEUR de l’OTAN devenu ensuite président des États-Unis, s’impose comme une figure hors du commun. Ardent défenseur du multinationalisme et de l’intégration militaire, celui que l’on surnommait « Ike » considérait l’OTAN comme un cadre indispensable de coopération transatlantique en matière de sécurité. Le lecteur en viendrait à regretter que l’ouvrage traite surtout des débuts de l’Alliance et ne contienne donc pas d’informations analogues sur des personnalités plus contemporaines.
Bien que Sayle se soit appuyé sur sa thèse pour rédiger Enduring Alliance, il fait l’impasse sur les ennuyeux chapitres dédiés aux théories politiques ou à la méthodologie de recherche, et il ne se perd à aucun moment dans ses sources. S’il est manifeste que l’auteur a disséqué un nombre impressionnant de documents, il évite résolument de se disperser. L’une de ses forces est d’ailleurs l’élégance avec laquelle il parvient à intégrer dans son récit des centaines de citations intéressantes sans jamais leur sacrifier la fluidité de sa prose. Il réussit même l’exploit de raconter de manière inédite des épisodes de l’histoire de l’OTAN pourtant déjà maintes fois contés par d’autres, comme celui du destin funeste de la force nucléaire multilatérale, dans les années 1960.
Au final, l’auteur ne rate sa cible qu’en de très rares occasions. Lorsqu’il explique, par exemple, que le sommet de Reykjavik, en 1986, entre les États-Unis et l’Union soviétique, était essentiellement – tant chez Reagan que chez Gorbatchev – le reflet d’un changement d’attitude à l’égard des armes nucléaires, il semble oublier la principale raison pour laquelle le secrétaire général du Parti communiste était prêt à proposer leur abolition : Moscou devait absolument mettre un terme à l’initiative de défense stratégique (IDS) de Washington et aurait payé pratiquement n’importe quel prix pour y parvenir. Curieusement, l’IDS n’est pas mentionnée dans le livre de Sayle, alors qu’elle est restée une véritable épine dans le pied de l’Union soviétique (ainsi que de l’OTAN) tout au long des années 1980. Les quelques omissions de ce type mériteraient d’être réparées dans une deuxième édition de l’ouvrage, laquelle gagnerait également à avoir un index.
À tous ceux qui croient que l’Alliance vit en ce moment une période particulièrement difficile, Enduring Alliance rappelle de façon salutaire qu’aplanir des divergences majeures entre Alliés n’est rien moins que le leitmotiv de l’OTAN depuis sa création. Qu’il s’agisse des craintes des Européens, au début des années 1960, de voir les États-Unis se désintéresser de l’Organisation, ou de celles de Washington, quelques années plus tard, de voir les Européens passer seuls des accords avec Moscou, Sayle nous montre que l’Alliance a toujours fait l’objet d’un processus de négociation au terme duquel prévalait la même logique : mieux vaut vivre avec l’OTAN que sans elle.
Parmi les livres écrits récemment sur l’OTAN, Enduring Alliance se démarque comme l’un des meilleurs. Il ne s’agit toutefois pas d’un manuel sur l’Organisation et ses structures, mais d’un ouvrage sur la politique, où l’institution internationale n’est que la toile de fond d’un récit fascinant sur le multilatéralisme politique, dont les acteurs s’efforcent constamment de trouver le plus petit commun dénominateur entre des intérêts nationaux souvent divergents tout en essayant de façonner ensemble l’environnement stratégique. En expliquant comment les Alliés sont parvenus à s’entendre malgré des désaccords parfois profonds, Sayle délivre un message rassurant : il existe bel et bien une communauté transatlantique.