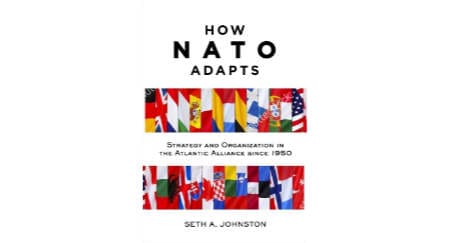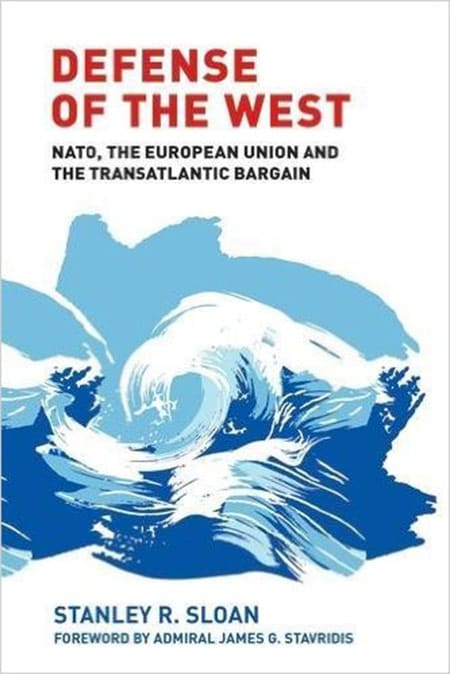À l’ère de la « post-vérité », où l’OTAN est devenue une cible prisée des campagnes de désinformation et des théories conspirationnistes en tout genre, il est rassurant de savoir que quiconque cherche des informations fiables sur l’Alliance atlantique pourra encore les trouver : « How NATO Adapts », signé Seth A. Johnston, et « Defense of the West », de Stanley R. Sloan, sont deux ouvrages extrêmement bien documentés sur l’évolution qu’a connue l’OTAN en près de 70 ans.
How NATO Adapts
Pour construire son récit, Johnston a choisi de braquer son projecteur sur les « moments charnières » de l’histoire de l’OTAN, ce parti pris narratif permettant, selon l’auteur, de poser un regard sur la façon dont les pays ont affronté les difficultés, mais aussi sur le rôle de l’Organisation. Un rôle sous-estimé si l’on en croit Johnston. Parmi les « moments charnières » retenus par l’auteur, l’ouvrage revient sur le début des années 1950, période pendant laquelle l’Alliance se mue en Organisation dans le sillage de la guerre de Corée et la question de l’avenir de l’Allemagne de l’Ouest au sein de l’OTAN se fait de plus en plus pressante. Il s’intéresse aussi au début des années 1960 et à la crise des missiles de Cuba, qui contraint les États-Unis d’Amérique (et, par extension, l’OTAN) à penser une stratégie moins centrée sur le recours précoce à l’arme nucléaire. Le troisième moment charnière (« et le plus connu d’entre tous ») est la fin de la Guerre froide, qui remet en cause l’existence même de l’OTAN.
En axant son récit sur les événements qui ont marqué l’histoire de l’OTAN, Johnston couvre un large éventail de sujets, sans faillir à la promesse de l’ouvrage, à savoir examiner le rôle moteur qu’a joué l’Organisation dans l’adaptation permanente de l’OTAN. Il rappelle par exemple les réformes institutionnelles qu’il a fallu engager à la suite du retrait de la France du commandement militaire intégré de l’OTAN en 1966 et du déménagement consécutif du siège de l’Organisation et de divers postes de commandement de la France vers la Belgique. Il revient également sur les ajustements opérés au sein de l’Organisation, notamment la constitution du Groupe des plans nucléaires, l’introduction de la riposte graduée et, surtout, le « rapport Harmel » de 1967, qui contribua à fédérer les Alliés autour d’un socle d’objectifs communs et à désamorcer la crise majeure provoquée par les lubies politiques de De Gaulle, alors président de la République française.
Cette approche narrative se heurte toutefois à des écueils manifestes. Les « moments charnières » retenus par Johnston sont certes plausibles, mais concentrer l’analyse sur certains événements majeurs comporte de fait le risque d’en négliger d’autres. Par endroits, le récit prend une tournure curieuse : la violente dissolution de la Yougoslavie est à juste titre présentée comme un catalyseur de la transformation de l’OTAN en structure de gestion de crises, mais les raisons de l’effondrement du pays sont complètement passées sous silence. La lutte qui s’est engagée au début des années 1980 avec le déploiement de nouvelles armes nucléaires en Europe, sans doute l’une des plus graves crises qu’ait connues l’OTAN, est à peine évoquée.
Si ces lacunes et autres omissions s’expliquent en partie par le parti pris narratif de l’auteur, on les doit également à son parcours : le récit porte en effet la marque du militaire de carrière américain. En conséquence, l’évolution de la stratégie et de la structure militaires de l’OTAN est analysée de manière approfondie, tandis que certaines questions politiques importantes sont examinées de façon expéditive.
En l’absence de sources, Johnston propose une description assez inégale du rôle joué par d’influentes personnalités, dont les secrétaires généraux et les commandants suprêmes des forces alliées en Europe (SACEUR) qui se sont succédé. Les informations que révèlent ces portraits sont toutefois suffisantes pour renseigner le lecteur sur les moyens créatifs que peuvent employer les bureaucraties pour s’adapter à des circonstances changeantes. Si la décision reste la prérogative des États, en cas de désaccord sur la marche à suivre, il revient à l’Organisation et à certains acteurs clés en son sein de se poser en « médiateur » et de dessiner des solutions crédibles favorisant le consensus.
Certains des points de vue avancés par Johnston semblent néanmoins tirés par les cheveux. Si l’on peut aisément convenir que le Secrétaire général Manfred Wörner fut « révolutionnaire » (p. 146), de par son style de direction affirmé et ses compétences en élaboration de programmes, on trouvera pour le moins étonnante l’évaluation positive que l’auteur fait de son successeur, Willy Claes. Dès les débuts de sa brève année de mandat, Claes est en effet mêlé à un scandale lié à un contrat d’armement, qui l’empêchera simplement de marquer de son empreinte la transformation de l’OTAN. Le choix de ne pas réunir le Conseil de l’Atlantique Nord pour que les frappes aériennes contre les Serbes de Bosnie puissent être opérées sans entraves témoigne peut-être de l’expérience de Claes en tant que politicien affûté, mais s’il s’agit là du seul acte de « leadership » que Johnston ait pu mettre en évidence, il aurait mieux fait de faire l’impasse sur cette partie. Il est aussi révélateur de constater que les secrétaires généraux Robertson, Rasmussen et Stoltenberg ne sont que brièvement mentionnés, Solana et de Hoop Scheffer étant tout bonnement absents de l’ouvrage. Pour une étude qui entend décrire les processus d’adaptation à l’œuvre au sein de l’OTAN, ce n’est pas suffisant.
Dans l’avant-dernier chapitre, où l’auteur cherche à couvrir le Kosovo, les attentats du 11-Septembre et l’Afghanistan en à peine quelques pages, l’analyse par « moments charnières » semble même contreproductive. À l’image du 11-Septembre, certains événements majeurs ne sont accompagnés d’aucune réelle explication, comme si l’auteur partait du principe que le lecteur maîtrise déjà bien le sujet. Quant à la guerre en Irak, qui a déclenché une crise d’une ampleur telle que l’ambassadeur des États-Unis auprès de l’OTAN, Nick Burns, en parlera comme d’une « expérience de mort imminente » pour l’OTAN, elle est à peine mentionnée. C’est d’autant plus surprenant que l’auteur est bien conscient que, si l’OTAN a repris la direction de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan en 2003, c’est en grande partie parce qu’il fallait rafistoler des relations transatlantiques tendues après la guerre en Irak.
Agréable à lire, « How NATO Adapts » renferme une foule d’informations solides. Il ne convainc toutefois pas par sa structure. Le fait de cibler des « moments charnières » et de faire la part belle aux questions militaires amène l’auteur à commettre certaines omissions graves, d’une part, et à poser certains jugements assez hasardeux, d’autre part. Cela compromet son utilité en tant que manuel scolaire. Pour le cercle des passionnés de l’OTAN, la richesse des informations fournies dans l’ouvrage compense néanmoins largement son articulation imparfaite.
Defense of the West
Le livre signé Stanley R. Sloan, « Defense of the West », n’a pas la prétention de proposer un angle d’analyse novateur, ce qui en fait sans doute un meilleur ouvrage que le précédent. Outre le fait de livrer un récit plus complet, l’auteur a su trouver un meilleur équilibre entre les dimensions politiques et militaires de l’évolution de l’OTAN. Le volume semble destiné à un public « étudiants », comme l’atteste la rubrique « questions à débattre » qui clôture chaque chapitre, mais il est à ce point exhaustif qu’on pourrait presque l’assimiler à un manuel OTAN.
Comme dans ses précédents ouvrages, Sloan part de la célèbre notion de « donne transatlantique » introduite par l’ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l’OTAN, Harlan Cleveland, pour définir l’Organisation. Sloan montre que l’évolution de l’OTAN a aussi modifié cette donne. Si le postulat de départ était assez simple (l’Europe d’après-guerre devait se relever et les États-Unis contribueraient à protéger le continent), la donne n’a cessé de se complexifier avec le temps. L’émergence, avec l’Union européenne, d’un nouvel acteur dans le paysage sécuritaire ou encore l’admission au sein de l’OTAN d’un grand nombre de nouveaux pays membres, mus par des intérêts nationaux propres, a entraîné de fait la superposition de nombreuses « donnes secondaires » (« subordinate bargains », comme les désigne Sloan).
Sloan comprend aussi les dilemmes inhérents à l’élaboration de politiques de sécurité, comme en témoignent les douloureux clivages qui ont divisé l’Organisation au moment d’élargir l’OTAN à de nouveaux membres d’Europe centrale et de l’Est, certains craignant de s’aliéner la Russie. Ainsi, concernant le Partenariat pour la paix, cadre de coopération instauré en vue d’un rapprochement des voisins de l’OTAN à l’Est, sans pour autant parler d’intégration au sein de l’Alliance, l’auteur explique : « Le Partenariat pour la paix était le rêve de tout décideur politique. Il signifiait aux pays aspirant à devenir membres qu’ils avaient été entendus, sans rien promettre pour l’avenir. Peut-être plus important encore, il permettait de temporiser. Tout en empêchant la déstabilisation des relations avec la Russie, [...] le Partenariat a réconcilié les partisans de l’élargissement au sein de l’administration américaine et ceux qui se montraient alors sceptiques » (p. 113).
C’est ce type d’analyses aiguisées qui placent le livre de Sloan au-dessus de la plupart des ouvrages consacrés à l’OTAN. De même, il pose un regard pertinent sur la campagne aérienne controversée de l’OTAN au Kosovo en 1999, ou l’opération menée en Lybie en 2011. Dans chaque cas, Sloan pèse le pour et le contre, sans jamais verser dans le discours moralisateur, pourtant caractéristique de tant d’autres publications.
Souvent sollicité des deux côtés de l’Atlantique pour ses conférences prisées, Sloan est parfaitement conscient non seulement des différentes perceptions nourries par l’Amérique du Nord et l’Europe sur les questions de sécurité, mais aussi de la pluralité des cultures politiques et des spécificités nationales que l’on trouve parmi les Alliés. Il leur consacre d’ailleurs un chapitre entier (chapitre 5). Sa capacité à exposer des points de vue divergents avec la même force de conviction est particulièrement utile quand il décrit des désaccords transatlantiques majeurs, comme pour la guerre en Irak en 2003. Sloan retrace les origines de la crise, mais il avance aussi des raisons probantes pour expliquer pourquoi l’Alliance lui a résisté : les intérêts stratégiques partagés et le socle de valeurs communes étaient suffisamment solides pour empêcher une rupture du lien transatlantique.
L’auteur réserve par ailleurs une part importante de l’ouvrage à l’avènement de l’Union européenne (UE), qui, selon lui, marque l’émergence d’une nouvelle réalité à prendre en compte dans la construction d’une relation transatlantique éclairée. Cela dit, il semble avoir abandonné la proposition utopique de ses précédents ouvrages, qui visait le regroupement de l’UE et de l’OTAN au sein d’une sorte de nouvelle Communauté atlantique. Dans le paysage actuel, cet idéal semble plus que jamais inatteignable.
L’articulation de « Defense of the West » n’est toutefois pas irréprochable. Par endroits, le flux narratif s’interrompt pour laisser place à des énumérations de type liste à points (par exemple, p. 193, et p. 201-204), qui donnent l’impression que ces parties ont été écrites à la hâte. L’avant-dernier chapitre, « External threats and internal challenges » (menaces externes et défis internes), qui répertorie des enjeux divers allant des cyberattaques à la collaboration inefficace entre l’OTAN et l’UE, s’apparente quelque peu à un chapitre fourre-tout regroupant toutes les questions qui n’ont pu être abordées ailleurs, même si l’on peut y voir une certaine utilité pour les étudiants.
Enfin, il y a la question de la longueur : avec plus de 370 pages (là où Johnston s’en tient à environ 250), le volume de Sloan fait appel à la patience du lecteur. Néanmoins, ceux qui s’en armeront se verront récompensés : « Defense of the West » est un récit exhaustif et équilibré de l’histoire passée et présente de l’OTAN.