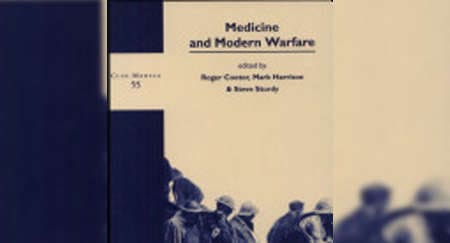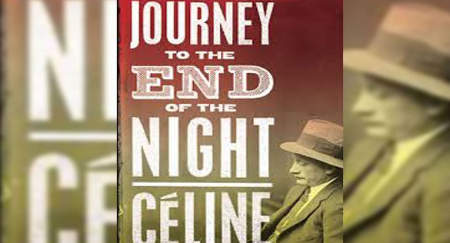Selon Hippocrate, « la guerre est la seule véritable école du chirurgien ». L’influence réciproque de la guerre et de la médecine fait encore débat aujourd’hui. L’un des principaux ouvrages sur le rôle de la médecine de guerre, Medicine and Modern Warfare, est paru en 1999, à l’aube du XXIe siècle.
L’ouvrage relate diverses expériences médicales sur différents champs de bataille, abordant tant la « médicalisation » de la guerre que la « militarisation » de la médecine. Il reste d’actualité aujourd’hui en ce qu’il démonte les clichés véhiculés, notamment, sur la corrélation entre guerre et maladies vénériennes ou entre guerre et traumatismes, de sorte qu’il a contribué à des études menées ultérieurement sur les traumatismes replacés dans le contexte historique.
L’étude sur le sexe et le soldat-citoyen (Sex and the Citizen Soldier) exposée dans l’ouvrage dépeint la guerre comme une crise sociale. Sans contester l’idée généralement admise que la Seconde Guerre mondiale a conduit à une libéralisation de l’opinion sur les maladies sexuellement transmissibles, l’étude avance que des cercles influents de la société britannique ont cherché à reprendre le contrôle du corps des citoyens (surtout des soldats et des prostituées) au nom de la santé, de la démocratie et du civisme. La transmission de maladies vénériennes était présentée non pas tant comme une offense à Dieu que comme un outrage à l’État.
La sécularisation de la lutte contre les maladies vénériennes durant la Seconde Guerre mondiale a marqué l’apogée d’une tendance perceptible depuis la Première Guerre mondiale. Le non-respect des consignes d’hygiène par les soldats britanniques a conduit les autorités militaires du Royaume-Uni et des autres Alliés à changer de méthode après 1942. Elles ont ainsi fermé les maisons closes de l’armée et ont interdit aux soldats de fréquenter les maisons closes civiles. Cependant, ce qui préoccupait désormais les autorités militaires, ce n’étaient pas tant les conséquences des maladies vénériennes sur les opérations militaires que les répercussions politiques et disciplinaires d’un taux élevé d’infection vénérienne, qui ternissait la réputation des Britanniques et leur image (la « britannicité ») chez eux et à l’étranger.
La Première Guerre mondiale suscite bien plus que toute autre guerre l’intérêt des historiens de la médecine (qui, depuis peu, s’intéressent surtout au phénomène de l’« obusite », une forme de stress post-traumatique). La Seconde Guerre mondiale, en revanche, n’a guère été abordée sous cet angle, les aspects médicaux de la guerre ayant fait l’objet de très peu d’écrits depuis la parution des récits officiels dans les années 1950 et 1960, et ce en dépit de la contribution importante de la médecine à la victoire militaire. En effet, les technologies médicales mises au point et utilisées durant la guerre 1939-1945 (transfusions sanguines en série, nouveaux médicaments et nouvelles thérapies, etc.) ont eu leur importance, mais pas autant que la mutation des rapports entre les mondes militaire et médical, qui a fait de la médecine une ressource technique incontournable.
Le chapitre consacré à la psychiatrie américaine pendant et après la Seconde Guerre mondiale met en évidence le changement profond d’opinion qui s’est opéré entre 1945 et le début de la Guerre froide au sujet des victimes psychiatriques de la guerre. Durant la guerre, les soldats souffrant de névroses d’angoisse et d’autres troubles psychiques liés au combat étaient pris en charge par des psychiatres militaires, qui étaient au fait des conditions régnant au front et considéraient l’angoisse comme une réaction naturelle aux affres du combat. Ces médecins militaires savaient, intuitivement à l’époque, qu’il fallait considérer certains comportements supposément anormaux comme étant normaux en comparaison de la folie de la guerre, qui rendait ténue la frontière entre folie et normalité.
Après la guerre, des psychiatres-psychanalystes qui n’avaient aucune expérience du combat ont imputé les troubles mentaux des anciens soldats non pas au traumatisme subi sur le champ de bataille mais à une prédisposition innée (la faute aux mères de ces jeunes hommes, accusées de les avoir protégés à l’excès et d’avoir réprimé la masculinité de l’Américain). Les anciens soldats furent ainsi privés de la possibilité de parler de leur expérience de la guerre.
Pour illustrer les graves séquelles de ce silence contraint sur le malade, l’ouvrage évoque le roman Voyage au bout de la nuit, de L.-F. Céline, dans lequel Bardamu, soldat durant la Grande Guerre, ne peut faire part à personne de son traumatisme, de son opposition à la guerre et de sa souffrance, ni aux militaires, ni aux médecins, ni même aux civils. Il ne peut le faire en raison du discours officiel en vigueur durant la guerre, qui exalte la bravoure de l’homme, le patriotisme et le sacrifice à l’effort de guerre.
Bardamu n’a pas la possibilité d’exprimer par des mots l’effroi qu’il ressent en permanence – il ne peut que se murer dans le silence et tomber malade. C’est là un problème médical qui reste on ne peut plus d’actualité. L’épigraphe de Histoire et trauma – La folie des guerres, livre écrit par deux psychanalystes français (F. Davoine et J.-M. Gaudillière) et paru d’abord en anglais en 2004 à New York, dit ceci : « Ce qu’on ne peut pas dire, on ne peut pas le taire ». Cette maxime aide peut-être à comprendre pourquoi le thème de prédilection des études actuelles sur les guerres est le syndrome de stress post-traumatique chez les soldats et les vétérans.