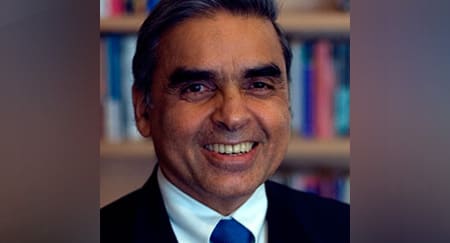Quelles ont été les surprises en matière de sécurité internationale en 2012, et quels enseignements peut-on en tirer ? Quatre experts comprenant entre autres une ancienne haute commissaire des Nations Unies et le chef d’un groupe de réflexion sur la sécurité indiquent quelles leçons ont été tirées de l’année 2012.
Louise Arbour
Louise Arbour préside l’International Crisis Group. Elle fut auparavant haute commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.
Sans que l’on puisse véritablement parler de surprise compte tenu de la scission notoire qui existe entre les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et des conséquences de l’intervention en Libye, cet organe international essentiel n’a pas été en mesure de prendre en main le dossier syrien en 2012, affichant ainsi une inefficacité de plus en plus patente. Avec 60 000 morts en Syrie, et 2,5 millions de personnes déplacées, l’instance mondiale chargée de maintenir la paix et la sécurité internationales donne encore un peu plus de grain à moudre à ses détracteurs et les appels à sa réforme revêtent un caractère plus urgent encore.
Michael Brzoska, Université de Hambourg
Le professeur Michael Brzoska, économiste et politologue, dirige l’Institut pour la recherche sur la paix et la politique de sécurité (IFHS) à l’Université de Hambourg
Je m’attendais à ce que les « Printemps arabes » aient des répercussions beaucoup plus vastes dans d’autres pays du Moyen-Orient, ainsi que dans d’autres parties du monde. Contrairement à de précédentes « vagues de démocratisation », les révoltes citoyennes qui avaient touché en premier lieu la Tunisie n’ont pas semblé faire beaucoup d’émules en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, ou en Asie centrale ou orientale, qui comptent toutes leur lot de régimes autoritaires. Même au Moyen-Orient, j’ai jugé surprenant que les activités de contestation des régimes en place se limitent à quelques pays seulement en 2012 (la Syrie étant celui qui a connu les plus grandes violences), et ce malgré des moyens de diffusion de l’information au niveau mondial bien plus perfectionnés qu’à l’époque de la vague de démocratisation globale de 1990/91, et en dépit de la réussite des révoltes en Tunisie, en Égypte et en Libye.
Je ne m’explique pas bien cette absence de propagation. Peut-être la crise économique mondiale a-t-elle éclipsé les préoccupations liées aux régimes politiques en de nombreux endroits du monde, ou peut-être la démocratisation a-t-elle semblé moins attirante en 2012 qu’il y a deux décennies ? Si c’était bien là l’explication, elle remettrait en question l’un des fondements essentiels de la philosophie sécuritaire occidentale.
Kishore Mahbubani
Kishore Mahbubani est le doyen de la « Lee Kuan Yew School of Public Policy » de l’Université nationale de Singapour, et l’auteur de « The Great Convergence : Asia, the West, and the Logic of One World. »
L’impossibilité pour l’ANASE de s’entendre sur un communiqué commun lors de sa session ministérielle de Phnom Penh en juillet 2012 a été un grand choc. C’était la première fois en 45 ans que l’Association connaissait un tel échec. Mais il s’agit peut-être d’un mal pour un bien.
L’ANASE va maintenant ressentir les effets de la nouvelle rivalité entre la Chine et les États-Unis. L’échec de Phnom Penh a été le premier signal d’un retour sur le champ de l’Asie du Sud-Est de la nouvelle rivalité entre grandes puissances.
Giles Merritt
Giles Merritt dirige les groupes de réflexion « Friends of Europe » et « Security & Defence Agenda », basés à Bruxelles. Il était auparavant journaliste au Financial Times.
Pour moi, la plus grande surprise a été la non-mobilisation de la Commission européenne en faveur de la fusion – 37,5 milliards d’euros - du groupe franco-allemand EADS, propriétaire d’Airbus, et du groupe britannique BAE Systems.
L’intégration des deux leaders en matière de technologie aéronautique de pointe et d’avionique paraissait devoir ouvrir la voie à une réussite industrielle que l’Union européenne appelait de ses vœux . En effet, depuis plusieurs années, les dirigeants de l’UE mettaient l’accent sur la nécessité de regrouper les industries de défense de l’Europe, et le projet de fusion – qui avait vu le jour au sein des conseils d’administration d’EADS et de BAE Systems – semblait répondre à ces appels. Or, tant la Commission que le Parlement européen sont restés silencieux et se sont abstenus d’apporter le soutien politique qui aurait pu permettre à l’opération de se faire.
Coïncidence bizarre : l’échec de la fusion est intervenu le jour où la Commission a dévoilé sa nouvelle stratégie industrielle pour que l’Europe reprenne l’avantage face à la concurrence de l’Asie et de l’Amérique du Nord. L’un des arguments les plus convaincants en faveur du mariage EADS-BAE avait été qu’il fallait s’attendre, selon les analystes de l’industrie, à ce que dans vingt ans la Chine se pose en rivale d’Airbus et de Boeing sur le marché mondial de l’aviation, et qu’elle ait, par ailleurs, mis en place une nouvelle industrie de défense puissante. Ce scénario apparaît d’autant plus plausible maintenant.
L’organe exécutif de l’UE est censé être le moteur des efforts de l’Europe pour relancer les industries qui sont à la traîne et de la lutte menée par le continent pour inverser la tendance au déclin économique à long terme dont la crise de la zone euro semble être le présage. Selon toute probabilité, le ratage de la fusion EADS-BAE ne méritera qu’une note en bas de page dans les livres d’histoire. Mais il marque peut-être le moment où la Commission européenne a reconnu ouvertement qu’elle n’était aujourd’hui guère plus qu’un secrétariat pour les gouvernements de l’UE, ce qui est bien loin du rôle de locomotive politique que certains Européens redoutent – et que d’autres espèrent encore.
Lire aussi:
[a CMSref=/2012/Predictions-2013/Impact-security-2013/EN/]Quel dossier influera, selon vous, de manière significative sur la sécurité en 2013, et pourquoi ? »[/a]