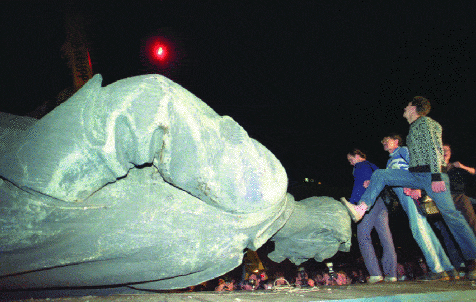Aujourd'hui, le moment est venu pour la Russie et pour l'OTAN de cesser de se voir à travers le prisme de la Guerre froide, affirme Fedor Loukianov. Les défis du XXIème siècle exigent que les deux parties remettent en cause les perceptions héritées du XXème siècle.
Aujourd'hui, plus de vingt ans après la fin de la Guerre froide, l'OTAN et la Russie ne sont toujours pas capables de trouver un terrain d’entente pour esquisser les contours d'une future coopération stratégique.
C'est déplorable, parce que les deux parties ont un besoin urgent l’une de l’autre, même si Moscou et les capitales de l’OTAN n’en sont pas pleinement conscientes. La Russie et l'Alliance sont confrontées aux mêmes problèmes, bien que ceux-ci aient des causes opposées. Tant la Russie que l'OTAN se sont avérées incapables, quoique de manière différente, de renoncer aux visions héritées du passé.
La Russie est toujours en phase de rétablissement après l'effondrement géopolitique provoqué par l'éclatement de l'Union soviétique. L’opinion publique et une grande partie de la classe politique russes sont instinctivement à la recherche de preuves que la désintégration de 1991 n’a pas signifié la disparition de la Russie en tant qu’acteur important sur la scène mondiale.
L'OTAN a été perçue comme une rivale heureuse et comme un symbole de la défaite stratégique de la Russie
Dans ce contexte, l'OTAN a été perçue comme une rivale heureuse et comme un symbole de la défaite stratégique de la Russie, et cette vision sous-tend la perception générale.
Il va sans dire qu’une telle approche - le complexe du perdant, en jargon psychologique - ne peut guère contribuer à une interaction constructive. La faiblesse intellectuelle de l'élite politique russe, incapable de s'adapter à la nouvelle ère, ajoute encore à la confusion générale.
Néanmoins, les choses évoluent. Dans un paysage international qui se modifie rapidement, la Russie s’éloigne progressivement de l’idée selon laquelle l'OTAN constitue la principale menace à sa sécurité. Actuellement, ses relations avec l'Alliance sont marquées par l’écho du passé. On ne sait pas encore quand cet écho va s’éteindre, mais il est de plus en plus discordant par rapport à d’autres réverbérations au niveau mondial, surtout en provenance d'Asie.
Les problèmes de l'OTAN tiennent à l'approche inverse. Je pense qu’elle n’arrive toujours pas à dépasser l'euphorie du vainqueur, et qu’elle continue de se présenter comme l'alliance militaire la plus efficace de tous les temps, ce qui pouvait être vrai il y a quinze ans, mais qui donne une image trompeuse aujourd'hui. Malgré sa puissance accumulée, l'OTAN est mal adaptée pour faire face aux défis du XXIème siècle. Au lieu d'affronter la réalité, elle tente de la contourner par une rhétorique politiquement correcte et l'autosuggestion.
Jusqu'à la fin des années 2000, la question des changements profonds qui s’imposaient au niveau des objectifs et de la mission de l'OTAN a été réglée par le biais de l’élargissement de l’Alliance. L'extension mécanique a atteint ses limites, mais elle n’a pas permis d’apporter des réponses aux nouveaux dilemmes stratégiques.
L'agenda post-Guerre froide de l’OTAN comme de la Russie est achevé (ou plutôt épuisé) et les deux parties doivent maintenant se prononcer sur leur nouvelle auto-identification au XXIème siècle
L'OTAN n’est pas devenue le gendarme du monde, et le seul problème qui subsiste dans sa zone de responsabilité initiale – l’Europe – est l’instabilité des relations avec Moscou. Asseoir solidement les relations OTAN-Russie, ce qui devrait commencer par un abandon de la perception dépassée que les deux parties ont l’une de l'autre, pourrait offrir une nouvelle perspective à l'OTAN en tant qu’organisation régionale.
Pour résumer la situation, l'agenda post-Guerre froide de l’OTAN comme de la Russie est achevé (ou plutôt épuisé) et les deux parties doivent maintenant se prononcer sur leur nouvelle auto-identification au XXIème siècle. Il est temps qu’elles procèdent à un repositionnement mutuel.
Les derniers développements ont été plutôt décourageants. Six mois de discussions sur la défense antimissile européenne, lancées lors du très prometteur sommet OTAN-Russie de novembre dernier, se sont soldés par un rejet sans équivoque de la proposition de coopération de la Russie par les responsables de l'Alliance. La réaction était prévisible: les responsables russes ont exprimé leur profonde déception et ont mis en garde contre le risque d'une nouvelle course aux armements.
Cette demi-année de discussions a-t-elle constitué une perte de temps? Non, car il ne fait aucun doute que tenter de mettre cette idée en œuvre en valait la peine. Le fait même que la question de la coopération sur un aspect aussi délicat de la sécurité nationale a été soulevée en termes pratiques montre que les deux parties sont effectivement en train de s'éloigner de la logique de la Guerre froide.
"L'OTAN ne peut pas confier à des pays non membres des obligations de défense collective qui lient ses membres"
Le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen
L'inertie et la puissance des préjugés sont énormes des deux côtés, mais la discussion est passée de la rhétorique des professions de foi, à caractère émotionnel, au domaine de la raison. Des détails importants ont été fournis sur la compatibilité technologique et les options politiques.
« L'OTAN ne peut pas confier à des pays non membres des obligations de défense collective qui lient ses membres », a dit le secrétaire général de l'Alliance, Anders Fogh Rasmussen. « Nous supposons que la Russie n'est pas prête non plus à céder sa souveraineté. » Cette dernière remarque est particulièrement intéressante. Comme l’ont fait observer de nombreux experts, les propositions que l’on pourrait qualifier de sensationnelles du président Dmitri Medvedev concernant une « défense antimissile territoriale » impliquaient la possibilité de discuter du principe jusque-là immuable de l’autonomie stratégique de la Russie. En d’autres termes, le président a fait une proposition qu’aucune administration du Kremlin n’avait jamais osé envisager, même à l’époque de l’esprit romantique pro-occidental du début des années 1990.
De toute évidence, il serait irréaliste de s'attendre à un aboutissement rapide et facile. La tentative retentissante de Moscou pour régler une question qui touche aux aspects fondamentaux de la sécurité était probablement vouée à l'échec. Tout accord dans ce domaine requiert un niveau très élevé de confiance mutuelle – qui fait défaut dans les relations russo-américaines, même si une certaine amélioration est intervenue au cours des deux années et demie qui viennent de s’écouler. Maintenant que nous comprenons qu’il n’y aura pas de percée, nous devons tirer les bonnes conclusions et minimiser les dommages causés par les attentes déçues. Cette première tentative valait de toute façon la peine d’être menée.
Une interaction à long terme entre l'OTAN et la Russie dans le dossier afghan est impossible car les deux parties ont des objectifs différents
On relèvera qu’avec le dialogue sur la défense antimissile européenne, la polémique sur une hypothétique adhésion de la Russie à l’OTAN a pris de l’ampleur. En 2010, on a beaucoup spéculé sur la question de savoir si la Russie pourrait un jour devenir membre de l’Alliance. Dans les publications occidentales, d’éminents analystes et d’anciennes personnalités politiques se sont exprimés sur l’opportunité et l’utilité d’une adhésion russe. Le Groupe d’experts chargé du Concept stratégique de l’OTAN, présidé par l’ancienne secrétaire d’État américaine Madeleine Albright, a procédé à un débat animé sur cette question, même si les conclusions des « sages » en la matière n’ont pas été incluses dans le texte exposant la nouvelle stratégie de l’Alliance.
En Russie, des libéraux pro-occidentaux de l’Institut du développement contemporain (INSOR) et même de hauts responsables réfléchissent à cette possibilité. Après le sommet de l’OTAN tenu à Lisbonne, où l’atmosphère fut très amicale vis-à-vis de Moscou, deux hauts responsables russes n’ont pas exclu la possibilité d’une adhésion de la Russie à l’Alliance dans le futur. Il s’agissait du chef adjoint de l’administration du Kremlin, Vladislav Sourkov, et du directeur du Département de planification de la politique du ministère des Affaires étrangères, Alexander Kramarenko.
Le débat n’a mené nulle part, mais, pour la première fois peut-être, ceux qui y ont pris part on invoqué des arguments spécifiques. Ils ne se sont pas contentés de dire « c’est impossible parce que cela ne pourra jamais se produire », mais ont expliqué pourquoi c’est impossible. En d’autres termes, le débat a finalement dépassé la rhétorique des professions de foi.
La question de la défense antimissile va inévitablement surgir à nouveau dans les relations entre la Russie et les États-Unis, qui, naturellement, façonnent les relations entre Moscou et l’OTAN. Tant que les deux pays posséderont des arsenaux nucléaires plusieurs fois supérieurs à ceux du reste du monde, la notion de stabilité stratégique – si obsolète qu’elle puisse sembler – réapparaîtra à l’ordre du jour. Mais, sous sa forme actuelle, la défense antimissile reste liée au contexte euro-atlantique plus large. En d’autres termes, elle ne s’est pas dégagée de la puissante inertie de la Guerre froide.
Ce débat sera peut-être envisagé sous un nouveau jour dans quelques années, lorsque toutes les parties prenantes comprendront que l’Europe n’est plus un théâtre stratégique. L’Asie prenant rapidement la place de l’Europe, la défense antimissile sera également de plus en plus associée à cette région. Cela signifie que le dialogue américano-russe se modifiera aussi, Moscou et Washington jouant en Asie des rôles totalement différents de ceux qu’elles jouent en Europe.
Le principe de base des alliances militaro-politiques du XXIème siècle sera très vraisemblablement différent de ce qu’il était au XXème siècle, à savoir une idéologie ou des valeurs communes. Dans les décennies à venir, les alliances seront probablement constituées pour atteindre un objectif concret. Comme l’a dit un jour Donald Rumsfeld, « c’est la mission qui détermine la coalition – ce n’est pas la coalition qui doit déterminer la mission. » Ces paroles se sont révélées plus durables que sa carrière politique.
Cela dit, même si l’on considère une adhésion de la Russie à l’OTAN comme réaliste, elle ne contribuerait en rien à faire face aux véritables problèmes sécuritaires du XXIème siècle. Ceux-ci devraient être abordés dans une nouvelle configuration – idéalement, une configuration trilatérale comprenant la Russie, la Chine et les États-Unis. Même si ces trois puissances ont des approches et des intérêts différents, elles ont le poids stratégique nécessaire pour régler les problèmes en Eurasie centrale, dans l’Extrême-Orient russe et dans la région du Pacifique.
Les alliés européens des États-Unis ne seront sans doute pas parties prenantes tant qu’ils ne se seront pas dégagés du bourbier afghan. Les raisons en ont été longuement exposées par le secrétaire américain à la Défense sortant, Robert Gates, lors d’un discours prononcé en juin à Bruxelles, soulignant l’éparpillement et le niveau insuffisant de leurs dépenses de défense.
Une interaction à long terme entre l'OTAN et la Russie dans le dossier afghan est impossible car les deux parties ont des objectifs différents : l’Alliance cherche des manières appropriées de quitter le pays, tandis que la Russie recherche des solutions durables dans son voisinage.
Mais actuellement, leurs intérêts se rejoignent, et les années à venir fourniront de bonnes occasions de gérer conjointement la transition. Cela renforcera la confiance mutuelle et le niveau de compatibilité opérationnelle, nécessaire pour une coopération ultérieure. Mais avant d’en arriver là, il faudra que l’OTAN et la Russie s’adaptent d’abord aux nouveaux défis.