Lors de leur réunion de février 2024, les ministres de la Défense des pays de l’Alliance ont officiellement adopté la « stratégie de l'OTAN relative aux biotechnologies et aux technologies d’amélioration des capacités humaines ». Les agents de l’OTAN qui ont participé à l'élaboration et à la finalisation de cette stratégie présentent ici l'une de ses principales caractéristiques : il s'agit du tout premier ensemble de principes d'utilisation responsable des biotechnologies et des technologies d'amélioration des capacités humaines en matière de défense et de sécurité.
Les biotechnologies et les technologies d’amélioration des capacités humaines (BHE) ne datent pas d'hier, mais l’accélération sans précédent des innovations en la matière est en train de changer profondément la donne. Stimulés par l'évolution constante de l’intelligence artificielle (IA), les nouveaux développements des technologies BHE conduisent à une véritable biorévolution, qui va transformer notre société, que ce soit dans les domaines des soins de santé et de la santé publique, dans celui de la production industrielle ou encore dans ceux de la sécurité et de la défense.
Grâce à ces avancées, il sera peut-être possible de répondre à certains des défis les plus ardus pour l’Alliance en matière de soins médicaux, d’environnement et de résilience. Imaginez un monde où la biofabrication et la biologie de synthèse offrent des alternatives plus écologiques qui réduisent les dépendances de nos chaînes d'approvisionnement, où des méthodes de biodétection permettent de repérer de manière plus précise et modulable de nouveaux germes pathogènes ou autres substances chimiques ou agents biologiques dangereux, et où des méthodes de stockage sur ADN représentent un substitut écologique à nos systèmes énergivores actuels.
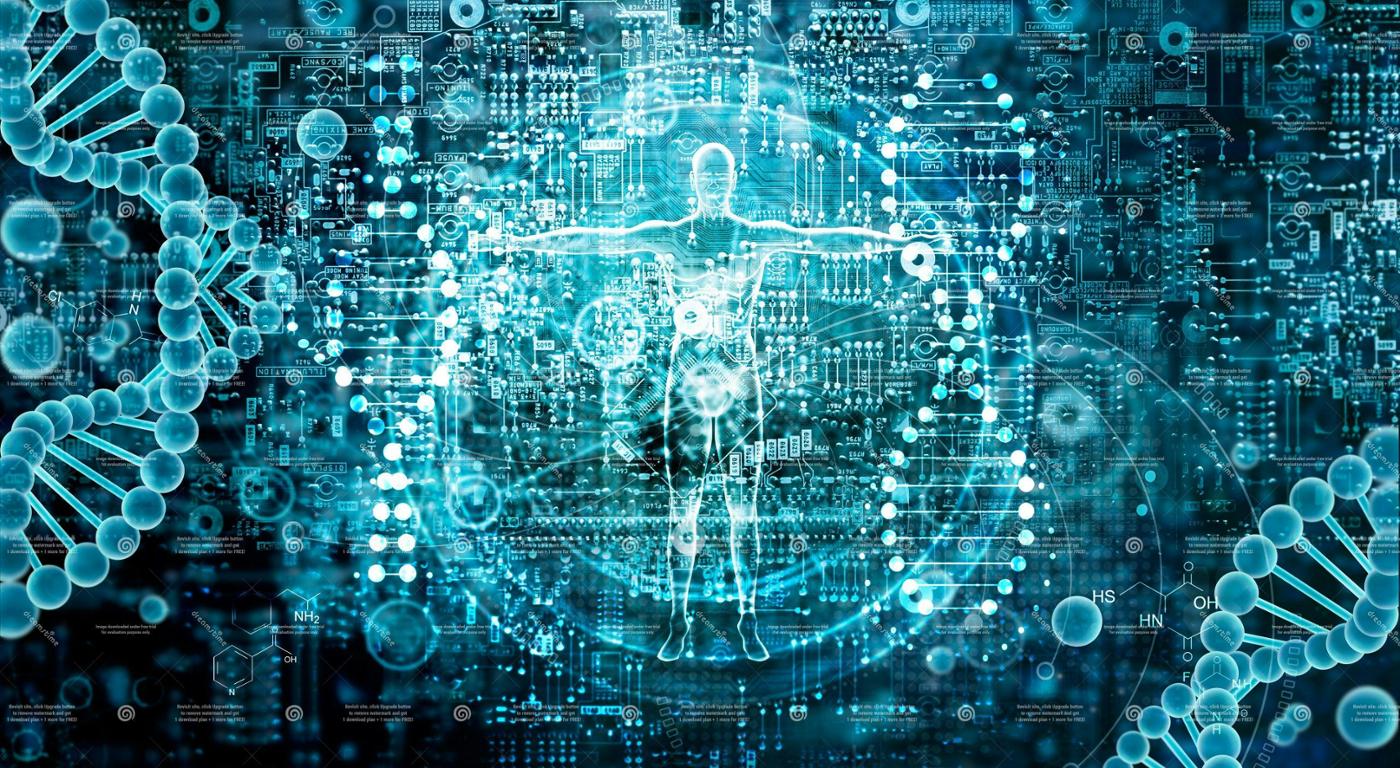
À l’instar de toutes les technologies émergentes et de rupture, les biotechnologies et les technologies d’amélioration des capacités humaines (BHE) représentent de nouveaux risques pour l’OTAN, en particulier entre les mains d’acteurs malintentionnés.
Photo reproduite avec l’aimable autorisation de Gareth / Wavell Room
À l’instar de toutes les technologies émergentes et de rupture, les technologies BHE représentent de nouveaux risques pour l’Alliance, en particulier entre les mains d’acteurs malintentionnés. Une même technique de génie génétique peut être utilisée à des fins d’innovation médicale ou pour créer de nouveaux agents pathogènes, plus létaux ou plus ciblés. Parallèlement, la prolifération des systèmes d’édition génomique et des méthodes de recherche fondées sur l’IA a réduit les budgets et les compétences nécessaires pour créer de potentielles menaces chimiques et biologiques ou pour s'approprier des moyens à cette fin.
En février 2024, les ministres de la Défense des pays de l’Alliance ont adopté la stratégie OTAN relative aux technologies BHE, le tout premier accord international régissant les biotechnologies émergentes dans le domaine de la défense et de la sécurité. Cette stratégie s'articule autour de principes d'utilisation responsable des technologies BHE, les tout premiers au monde s'appliquant au domaine de la défense et de la sécurité. Elle réaffirme en outre l’inébranlable engagement de l’Alliance envers la convention sur les armes biologiques. En mettant en œuvre cette nouvelle stratégie, l’Alliance a l’opportunité de faire progresser le développement et l’utilisation des technologies BHE à des fins défensives et pacifiques tout en prévoyant des moyens de protection contre les risques de prolifération qu’elles comportent.
Risques et avantages des biotechnologies et des technologies d’amélioration des capacités humaines
Le terme « biotechnologies » désigne le vaste domaine technologique où, à partir de processus biologiques, de cellules ou de composants cellulaires, on cherche à développer de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Les technologies d’amélioration des capacités humaines incluent quant à elles toutes les interventions, qu’elles relèvent ou non des biotechnologies, qui permettent de dépasser les limites et capacités humaines normales. Elles sont donc liées aux biotechnologies, mais se classent néanmoins dans une catégorie distincte.

Les technologies d’amélioration des capacités humaines incluent toutes les interventions, relevant ou non des biotechnologies, qui permettent de dépasser les limites et capacités humaines normales.
Photo © Commandement allié Transformation de l’OTAN
Les biotechnologies ont des domaines d’application variés: conception de biomatériaux plus résistants, plus légers et plus écologiques que les matériaux actuellement utilisés par nos militaires, amélioration de nos moyens de défense chimique et biologique grâce à une détection, une identification et un contrôle plus efficaces, ou encore production de courants électriques à l’aide de microbes afin de réduire le fardeau énergétique.
Quant aux technologies d’amélioration des capacités humaines, elles semblent prometteuses en médecine militaire et pour la rééducation des opérateurs. Quelques exemples : certaines découvertes capitales en médecine régénératrice pourraient un jour permettre de réparer des tissus ou des organes endommagés, de nouvelles approches en matière de prise en charge psychologique permettent déjà de mieux traiter le syndrome de stress post-traumatique, notamment à l’aide de thérapies utilisant la réalité virtuelle, des prothèses dotées d’IA permettent d'améliorer la qualité de vie de beaucoup de personnes ayant perdu des membres ou des extrémités, et des technologies portables, ingestibles et implantables peuvent soigner des affections touchant plus particulièrement les militaires et les vétérans.
Les acteurs de l’innovation, les investisseurs et les instituts de recherche des pays de l’Alliance font clairement avancer ces développements. À mesure que les percées technologiques se multiplieront dans les années à venir, de nouvelles opportunités s’ouvriront pour renforcer notre résilience collective, offrir des soins aux opérateurs militaires et permettre la transition énergétique de nos armées.
Dans le même temps, toutefois, les compétiteurs stratégiques et les adversaires potentiels de l’Alliance continueront également à investir dans les technologies BHE, cherchant activement à les mettre à profit dans des environnements opérationnels et aux fins de tactiques de guerre hybride. Les technologies BHE, en particulier lorsqu’elles sont combinées à des outils fondés sur l’IA, peuvent être utilisées à mauvais escient afin de créer et de diffuser de nouveaux agents pathogènes. Ce défi de sûreté biologique nécessitera une vaste coopération internationale.
Si aucune collaboration scientifique transfrontière n’est mise en place au niveau international, l’OTAN et ses pays membres décrocheront face aux prochaines percées des technologies BHE. De la même manière, aucun pays ne peut se protéger seul contre les nouveaux risques de prolifération biologique. Une coopération étroite entre les Alliés et les partenaires intéressés par ces technologies et partageant les mêmes valeurs aboutira à des innovations et renforcera notre sûreté biologique. La définition par l’OTAN d’une approche responsable en matière de technologies BHE est une étape cruciale pour atténuer les risques qu’elles posent tout en tirant profit au maximum des nouvelles opportunités qu’elles offrent à l'Alliance.
L’approche responsable de l’OTAN en matière de technologies BHE
L’OTAN est une Alliance qui repose sur des valeurs communes : le développement et l’utilisation responsable des technologies BHE constituent donc un principe fondamental de sa stratégie. Son approche consiste à réaffirmer les cadres existants - en particulier la convention des Nations Unies sur les armes biologiques et d’autres obligations et engagements connexes pris par les pays de l’Alliance aux niveaux national et international -, ainsi que les principes de bioéthique et les principes OTAN d’utilisation responsable de l’IA au service de la défense et de la sécurité.
Les Alliés et l’OTAN se sont engagés à veiller à ce que les applications des technologies BHE qu’ils développent et adoptent respectent à chaque étape de leur cycle de vie les six principes d'utilisation responsable de l’IA énoncés ci-après.

Les technologies d’amélioration des capacités humaines mises à la disposition de nos personnels ne sont utilisées qu’avec leur consentement explicite et éclairé, conformément aux bonnes pratiques des services de santé des armées et dans le respect de la personne.
Photo © Commandement allié Transformation de l’OTAN
Légalité - Les applications des technologies BHE sont développées et utilisées dans le respect des législations nationales et du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits de la personne, selon les cas.
Responsabilité - Les applications des technologies BHE sont développées et utilisées avec le discernement et la prudence nécessaires ; les responsabilités humaines sont clairement définies afin que l’obligation de rendre compte puisse être respectée.
Sécurité et sûreté - Les technologies BHE ne sont utilisées que si elles ont satisfait à des procédures de sécurité strictes, lesquelles peuvent inclure des batteries d’essais et/ou de tests, si elles répondent aux normes applicables et/ou, à défaut, s’il a été démontré, au regard de l’état des connaissances scientifiques, qu’elles sont sûres et utiles pour l’humain et l’environnement.
Agentivité humaine - L’individu n’est pas privé de son sens du jugement ni de sa liberté de conscience de sorte qu’il conserve sa dignité humaine innée.
Consentement éclairé - Les technologies d’amélioration des capacités humaines mises à la disposition de nos personnels ne sont utilisées qu’avec leur consentement explicite et éclairé, conformément aux bonnes pratiques des services de santé des armées et dans le respect de la personne.
Durabilité : L’impact potentiel des technologies BHE sur l’environnement est évalué.
Les principes OTAN d'utilisation responsable des technologies BHE dans le domaine de la défense et de la sécurité ont été élaborés dans un cadre public en collaboration avec des experts de divers pays de l’Alliance et pays partenaires venant du monde universitaire, du secteur privé et d’autres organisations internationales. Chacun dans leur discipline, les experts ont analysé sous les angles juridique, éthique, culturel et scientifique quelles devraient être, dans ce domaine particulier, les pratiques d'utilisation responsable de ces technologies. Les contributions de ces experts témoignent de l'approche collaborative adoptée par l’Alliance dans son processus décisionnel, approche qui a permis de prendre en compte les points de vue des Alliés et de leurs partenaires technologiques dans l'élaboration de ces principes applicables aux technologies BHE.
Les Alliés sont déterminés à mener plus avant le développement des technologies BHE en respectant les cadres juridiques et leur ferme engagement en faveur d'innovations responsables. Ils réaffirment en particulier dans leur stratégie que le travail de l’OTAN sur ces technologies ne doit jamais aller à l’encontre de la convention sur les armes biologiques ni d’aucune autre obligation ou d’aucun autre engagement pris par les Alliés, que ce soit au niveau national ou international.

Les Alliés sont déterminés à mener plus avant le développement des technologies BHE en respectant les cadres juridiques et leur ferme engagement en faveur d'innovations responsables. Ils réaffirment en particulier dans leur stratégie que le travail de l’OTAN sur ces technologies ne doit jamais aller à l’encontre de la convention sur les armes biologiques. Photo reproduite avec l’aimable autorisation du Brookings Institute
Il y a deux aspects importants à prendre en compte concernant l’utilisation responsable des technologies d’amélioration des capacités humaines : le caractère réversible et la nature invasive de ces dernières. Les interventions réversibles (par exemple les stimulants tels que la caféine) sont limitées dans le temps, tandis que celles qui sont irréversibles (telles que des prothèses permanentes) ne le sont pas. De même, les interventions invasives (comme le placement d’un pacemaker) sont différentes de celles qui sont non invasives (comme les biocapteurs intégrés dans des uniformes). Ces divers aspects conduisent à des dilemmes éthiques, qu'il faut toutefois nuancer. En effet, les améliorations permanentes ne sont pas toutes forcément indésirables. Par exemple, les personnes qui subissent une chirurgie des yeux au laser espèrent généralement que ses effets perdurent. Ainsi, si la réversibilité et le caractère invasif des technologies d’amélioration des capacités humaines permettent de cadrer les discussions d'ordre éthique, il faut dans tous les cas tenir compte des risques qu'ils impliquent, sans oublier d'intégrer le devoir de sollicitude dans toutes les prises de décision.
Ces principes sont un signal adressé à la communauté internationale, qui doit savoir que l’Alliance veillera activement à atténuer les risques pouvant découler des technologies BHE tout en continuant à développer celles-ci dans des contextes de santé militaire, de résilience ou de transition énergétique. Bien que ces principes viennent renforcer la détermination des pays de l’Alliance à adopter des technologies BHE responsables, ils ne suffisent pas à garantir que les technologies BHE de l'Alliance seront effectivement développées et utilisées de manière responsable. Ils doivent donc être opérationnalisés, ce qui nécessite plusieurs cadres concrets qui s’appliquent à toutes les étapes du cycle de vie de chaque technologie. L’OTAN s’y emploie activement.
Rendre les principes opérationnels
La solidité des principes est toujours proportionnelle à l'effort consenti pour les rendre opérationnels. Nous nous attarderons ici sur deux moyens d'y parvenir : les trousses à outils et la formation.
Les trousses à outils
Les pays de l’Alliance sont conscients des nombreux points de convergence entre les technologies BHE et les applications de l’IA. Dans ce contexte, l’OTAN doit optimiser les synergies entre les principes d'utilisation responsable des technologies BHE et les mesures prises pour opérationnaliser les principes OTAN d’utilisation responsable de l’IA. Les trousses à outils promouvant une IA responsable élaborées et partagées par le Comité de surveillance Données et IA constituent une base solide pour ce qui est d'opérationnaliser les technologies BHE de manière responsable. Elles sont fondées sur des pratiques d’ingénierie multidisciplinaires qui visent à intégrer l'utilisation responsable dès la conception, et certaines de leurs fonctionnalités comprennent des évaluations des risques et des incidences. Ces évaluations, mais aussi d’autres outils tels que les normes développées pour l’IA responsable, pourraient être appliquées aux technologies BHE. Réaliser ces évaluations nécessite de consulter des experts de divers domaines tels que la biologie moléculaire, la biochimie, le génie génétique et biomédical, la médecine, la psychologie et la sociologie, la philosophie appliquée, la bioéthique, la robotique ou encore l’ergonomie.

Les trousses à outils dédiées à l’IA sont fondées sur des pratiques d’ingénierie multidisciplinaires qui visent à intégrer l'utilisation responsable dès la conception. Certaines de leurs fonctionnalités comprennent des évaluations des risques et des incidences, ce qui nécessite de consulter des experts de divers domaines tels que la biologie moléculaire, la biochimie, le génie génétique et biomédical, la médecine, la psychologie et la sociologie, la philosophie appliquée, la bioéthique, la robotique ou encore l’ergonomie. Photo reproduite avec l’aimable autorisation de Nutra Ingredients Europe
Plusieurs caractéristiques propres aux technologies BHE doivent être dûment prises en considération lorsque les pratiques d’innovation responsable sur lesquelles on s’appuie proviennent d’autres domaines technologiques. Par exemple, certaines technologies BHE pourraient présenter des risques d’addiction ou de dépendance pour les opérateurs, un facteur qui doit être intégré dans toute évaluation des risques et des incidences. Il conviendra également de tenir compte de la disparité de leurs effets sur les individus ou sur les groupes, sur les femmes ou les hommes, ou encore sur les militaires d’active ou sur les réservistes, sans oublier leurs incidences à plus long terme, notamment en termes de retour à la vie civile. Les effets potentiels sur l’environnement devront également être analysés.
L’innovation responsable consiste autant à définir une trajectoire positive qu’à éviter ou à atténuer les risques découlant d’évolutions technologiques indésirables. Opérationnaliser les principes ne signifie donc pas simplement atténuer les risques : il s’agit aussi d’améliorer la santé et le bien-être du personnel militaire grâce aux innovations médicales permises par la biotechnologie, de manière proactive durant leur service et après leur départ à la retraite. Il en est de même pour les technologies BHE hors du domaine médical, par exemple les initiatives de biofabrication de matériaux moins toxiques que nos alternatives chimiques actuelles.
Il est important de tester, d’évaluer, de valider et de vérifier les technologies BHE non seulement pour établir les nécessaires protocoles de sécurité, mais également pour veiller à ce que leurs utilisateurs conservent leur liberté cognitive pour chacune de leurs décisions. Ces trousses à outils doivent par ailleurs être aussi conviviales que possible, de manière à gagner la confiance de toutes les parties prenantes, puis à améliorer ses composants grâce à des boucles de retour d’information.
Formation et connaissances des biotechnologies
Pour pouvoir opérationnaliser ces principes, il est également crucial de bien informer les différentes parties prenantes sur le développement et l'utilisation responsables des technologies BHE en matière de défense et de sécurité. Les supports à cet effet seront probablement différents en fonction de leurs cibles, selon qu’il s’agit des utilisateurs finaux, des acteurs de l’innovation ou du grand public.
Les utilisateurs finaux à qui l'on demanderait de donner leur accord pour une intervention recourant aux technologies BHE devraient impérativement recevoir une formation délivrant des informations de qualité, précises et compréhensibles par des non-experts. Proposer une formation efficace signifie également maintenir la transparence et gagner la confiance des parties prenantes, par exemple lorsque des interventions biomédicales sont jugées nécessaires pour la santé et la sécurité de personnes et d'unités.
Les acteurs de l’innovation doivent quant à eux être sensibilisés aux incidences potentielles de leurs recherches et de leurs produits, conformément aux nouveaux principes des technologies BHE. En accord avec l’approche responsable sur laquelle elles s’appuient, les deux nouvelles initiatives de l’OTAN encadrant l’innovation – l’Accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord (DIANA) et le fonds OTAN pour l'innovation (NIF) – seront des instruments importants pour opérationnaliser les principes des technologies BHE durant leur phase de développement.
Le grand public devrait également être informé de l’approche responsable de l’Alliance à l’égard des technologies BHE et de son engagement à respecter le droit international, notamment la convention sur les armes biologiques. Conformément à nos valeurs communes, des informations doivent être diffusées de manière proactive auprès du grand public afin de mieux faire connaître les applications des technologies BHE à vocation pacifique ainsi que les risques que posent un recours abusif à celles-ci.
Dans l’année à venir, l’OTAN s’emploiera à créer des outils de formation sur les biotechnologies qui seront mis à la disposition des publics en ligne. Ce sera une opportunité concrète pour l’OTAN d’échanger avec des experts externes issus du monde universitaire, du secteur privé et de la société civile dans le but d’instaurer un climat de confiance avec les parties prenantes et de prévenir tout risque de désinformation dans ce domaine.
Conclusion
Il est essentiel de veiller à ce que l’Alliance développe de manière responsable les technologies BHE, y compris celles qui pourraient nous protéger contre un recours abusif à ce type de technologies. Il est urgent que nous agissions pour faire en sorte que les technologies BHE de l’Alliance soient développées dans le respect de nos valeurs, de nos principes et de nos lois.
Promouvoir et protéger ces technologies de manière responsable est un effort qui implique l’ensemble de la société dans chaque pays membre de l’Organisation et auquel nos nombreuses parties prenantes à travers l’Alliance et nos pays partenaires doivent être associées. C’est l’affaire de tous, depuis nos décideurs jusqu’aux initiatives en faveur de l’innovation – tels que DIANA et le NIF – en passant par nos acteurs de l’innovation, nos investisseurs, nos opérateurs et les publics au service desquels l’OTAN travaille.
À travers sa stratégie relative aux technologies BHE, l’Alliance affirme sa détermination à exploiter de manière responsable le plein potentiel de ces technologies.
